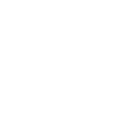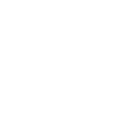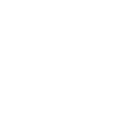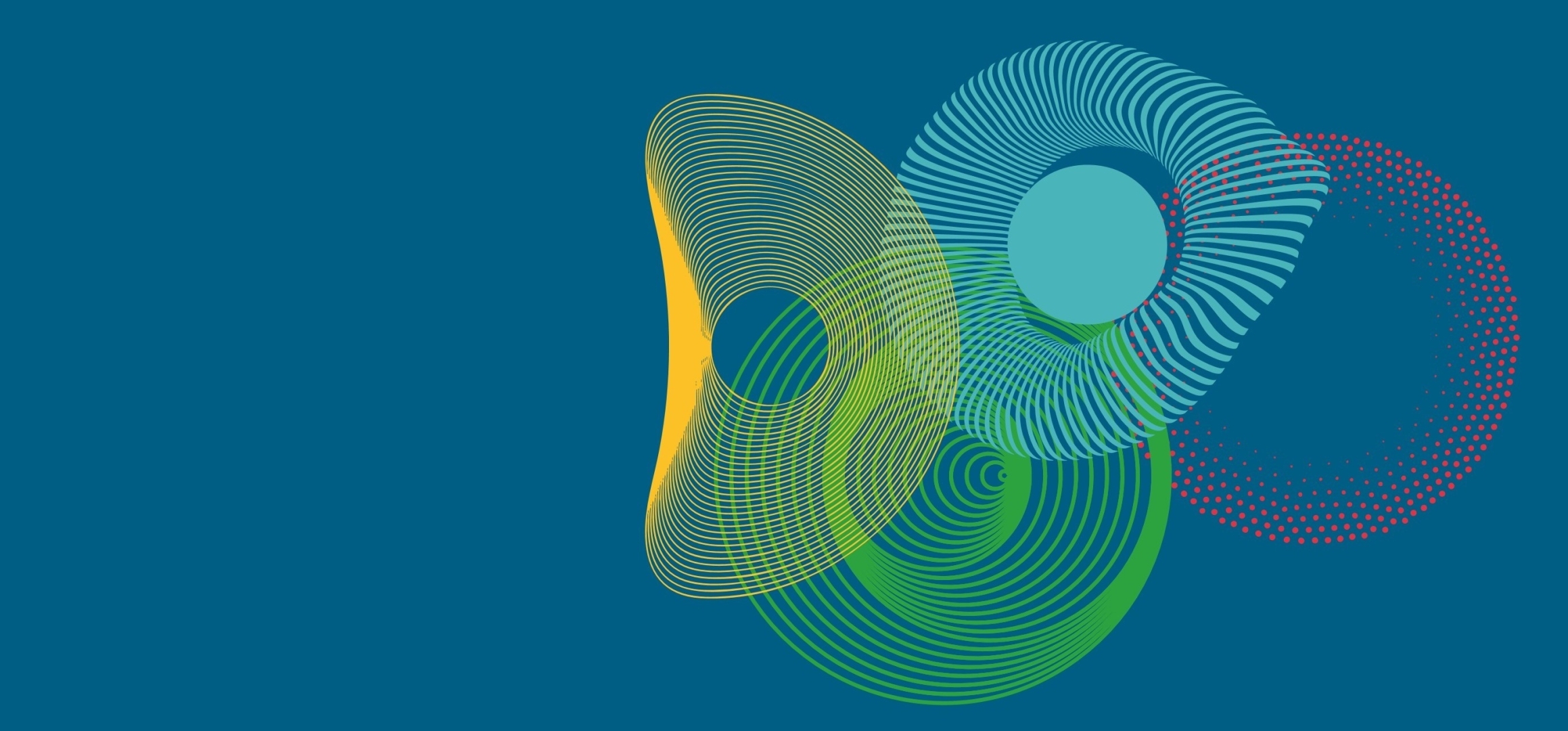Décanat de la recherche et de la création
Stratégie de la recherche et de la création 2025-2030
ACCÈS AU DOCUMENT SOURCE
Préambule
La Planification quinquennale de la recherche et de la création de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) est le fruit d’une démarche de consultation des acteurs clés de notre écosystème universitaire. Les travaux de la planification stratégique de la recherche et de la création font suite à un état des lieux détaillés remis au Vice-rectorat à la recherche, à la création, aux partenariats et à l’internationalisation (VRRCPI) en mars 2023, comme prévu par le Plan stratégique institutionnel 2022-2026 de l’UQO[1].
L’ensemble des professeur·es a été associé et un groupe de travail ad-hoc comportant une à deux personnes représentantes désignées de chaque école et département avec une représentation des trois sites de l’UQO. Ce groupe s’est réuni à trois reprises au printemps 2025 avec le mandat de finaliser la rédaction et de recommander l’adoption de la planification quinquennale de la recherche et de la création devant les instances directionnelles de l’UQO.
À cet égard, le Doyen et l’équipe du Décanat de la recherche et de la création (DRC) tiennent à souligner l’importante contribution du corps professoral à l’élaboration de cette planification.
Les quatre fonctions de la stratégie :
Rappeler les principes inhérents à la conduite de l’administration interne de la recherche et de la création à l’UQO.
Souligner les grands axes de la recherche et de la création à l’UQO afin de mieux refléter les contributions de notre institution à la société.
Mettre en place une série de priorités et d’actions pour le développement de l’offre de soutien aux personnes chercheuses et créatrices de l’UQO.
Planifier les résultats et les retombées attendus à l’issue de la période d’exercice pour la formulation de la stratégie.
1. Les principes de la recherche et la création à l’UQO
Conformément à son mandat, le DRC tient à rappeler l’importance du soutien accordé autant à la recherche qu’à la création dans la définition de la planification quinquennale ainsi que dans la mise en œuvre des politiques et programmes internes qui y sont associés. Il insiste également sur l’accompagnement des opportunités externes ainsi que sur l’établissement de réseaux de collaborations et de partenariats valorisant l’expertise et la richesse des travaux de nos chercheur·ses et de nos créateur·trices. Bien que la standardisation et l’évolution des politiques et des modes de fonctionnement de l’administration de la recherche universitaire soient une réalité, cette planification intègre et défend un certain nombre de principes fondamentaux. Ceux-ci tiennent lieu de déclaration d’engagement de l’établissement envers notre communauté de recherche et de création.
1.1. POSITIONNER L’UQO DANS L’ÉCOSYSTÈME GLOBAL
1.1.1. L’accentuation d’une université innovante, ancrée dans ses réseaux de collaborations et en mesure d’agir, et ce, autant sur le plan local qu’aux échelles nationales et internationales. L’internationalisation des projets de recherche et de création et de leurs résultats est partie intégrante aux efforts et à la mission de l’UQO pour soutenir le travail intellectuel et artistique de notre communauté.
1.1.2. Le maintien d’un dialogue constant et fréquent avec les principaux organismes subventionnaires (incluant ceux dédiés à la création)[2] et nos différents partenaires afin de mieux faire connaître les réalités propres des petites et moyennes universités[3] et d’assurer qu’elles soient prises en compte dans les orientations et les programmes. Cette mission de représentation requiert une attention particulière aux enjeux partagés par les universités francophones dans un monde où l’anglais prédomine sur la scène scientifique. Fait notable, le groupe des U15 capte plus de 79 % du financement de la recherche, bien qu’il représente que 59 % des personnes étudiantes inscrites aux cycles supérieurs et environ 50 % du corps professoral[4].
1.1.3. Le souci constant de la conduite responsable en recherche de l’UQO à l’endroit des organismes subventionnaires[5] et de la gouvernance des politiques provinciales et fédérales en recherche. Cela nécessite de trouver un juste équilibre dans les exigences relatives à la gestion des processus internes, et ce, dans le souci d’améliorer l’agilité institutionnelle tout en soutenant davantage les professeur·es dans la rationalisation de leur charge administrative.
1.2. FÉDÉRER NOTRE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE ET DE CRÉATION
1.2.1. La valorisation de la diversité des cadres disciplinaires ainsi que des traditions épistémologiques et méthodologiques qui fondent les pratiques de recherche et de création. Cette reconnaissance constitue un pilier dans la structuration de la communauté de recherche et de création de l’UQO. En valorisant cette diversité et ces traditions, cela permet de mieux soutenir les chercheur·ses et créateur·trices dans leurs approches spécifiques ; de renforcer leur sentiment d’appartenance, et de favoriser des contributions distinctives et complémentaires aux grands enjeux scientifiques et sociétaux.
1.2.2. L’encouragement aux dialogues scientifiques intégrant une pluralité de perspectives, lorsque pertinent, dans la formation des unités et des regroupements de recherche et de création. Cela dans l’optique de l’étude appliquée d’enjeux complexes de société et de la réalisation des axes stratégiques de la recherche et de la création de l’UQO.
1.2.3. La protection de la liberté académique[6] et, plus largement, le respect de l’indépendance intellectuelle de nos professeur·es constituent un principe cardinal pour l’UQO. Ce principe se fonde sur une défense active de la diversité des formes de recherches conduites et des cadres de pensée critique inhérents à la démarche scientifique[7]. L’UQO tend à accorder un même niveau d’attention et de soutien aux travaux qui ne nécessitent pas le dépôt de demandes de subventions à l’externe. Elle entend également militer activement en faveur de l’accès aux données et de la science ouverte au travers de ses déclarations et de ses actions[8].
1.2.4. La valorisation de la recherche interuniversitaire, partenariale et citoyenne comme levier pour renforcer la mission de service à la collectivité de l’université. L’UQO encourage la cocréation des connaissances avec les communautés et les milieux de pratique, de même que le savoir expérientiel et la dissémination sous toutes ses formes des connaissances développées par l’université avec le concours de ses partenaires.
1.3. UN DÉCANAT AU SERVICE DE LA CARRIÈRE DE SES CHERCHEUR·SES ET DE SES CRÉATEUR·TRICES
1.3.1. Le soutien aux chercheur·ses et aux créateur·trices qui choisissent de déposer une demande de subvention ou de développer une entente de collaboration avec un partenaire, repose sur des mécanismes d’accompagnement rigoureux et évolutifs[9]. Cette démarche vise à bonifier les dossiers, à maximiser les chances de succès et à reconnaître la pluralité des trajectoires, dans une perspective d’amélioration continue des résultats universitaires aux différents concours. Les services du Décanat intègrent également la valorisation des résultats issus des travaux de recherche réalisés par la communauté de l’UQO, conformément aux dispositions de la Politique et règles en matière de gestion de la propriété intellectuelle.
1.3.2. L’adoption d’une approche adaptative du soutien logistique et matériel afin de répondre aux besoins spécifiques et changeants de la communauté de recherche et de création de l’UQO. Le Décanat agit en tant qu’interlocuteur stratégique auprès de l’UQO afin de faire valoir l’importance d’un accès optimal aux bases de données, logiciels, infrastructures numériques, matériel informatique et aux formations spécialisées. Cette action vise à bonifier continuellement les conditions de recherche et de création, en cohérence avec les objectifs institutionnels de performance, de rayonnement, d’équité et d’appui à l’innovation.
1.3.3. L’engagement envers l’équité dans la carrière en recherche et en création, par l’identification et la réduction des barrières systémiques. Cette démarche repose sur une analyse continue des processus et règles institutionnels, afin de garantir des conditions propices à la satisfaction et l’épanouissement dans les activités de recherche et de création[10].
1.3.4. La reconnaissance de la diversité des trajectoires de recherche, à tous les âges et à toutes les étapes du parcours professionnel. L’UQO entend que les parcours académiques sont variés et non linéaires, tant pour les professeur·es que pour les personnes étudiantes. Elle affirme l’importance d’inclure et de soutenir celles et ceux qui amorcent une carrière académique ou des études supérieures à un âge plus avancé, souvent après un parcours professionnel en dehors des murs de l’université. Elle voit dans cette diversité d’expériences, une source de richesses pour la recherche, la formation et la vie universitaire. Cela pour encourager les échanges intergénérationnels et expérientiels, et pour en faire des leviers de transmission et d’innovation.
1.3.5. Une accentuation des efforts déployés pour la relève en recherche par la mise en place d’opportunités d’initiation à la recherche pour les personnes étudiantes du premier cycle ainsi que la professionnalisation en recherche pour les personnes étudiantes des cycles supérieurs, les chercheur·ses de niveau postdoctoral et les professeur·es en début de carrière.
2. Les quatre principaux axes de la recherche et de la création à l’UQO
De la gestion des risques climatiques, de la biodiversité, de la pollution à la transition énergétique, la décarbonisation et l’économie verte.
Cet axe vise à soutenir le développement de stratégies d’atténuation et d’adaptation permettant d’accroître la résilience des écosystèmes et des sociétés face aux changements environnementaux. Il fait appel aux sciences humaines et sociales ainsi qu’aux sciences naturelles et génies pour promouvoir le développement de solutions face à des changements environnementaux qui s’opèrent à l’échelle globale tels que les changements climatiques, la pollution systémique et la crise de la biodiversité. Pour ce faire, l’axe vise à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes principalement en zone tempérée, incluant les écosystèmes agricoles, aquatiques, forestiers et urbains, et ce, afin de guider leur aménagement et leur conservation. Il s’intéresse aux dynamiques de la transition énergétique vers une économie verte, notamment à la décarbonisation, aux risques associés aux changements réglementaires, technologiques ou sociaux, ainsi qu’à la gestion responsable des marchés financiers dans ce contexte. De manière transversale, cet axe intègre : la responsabilité sociale ; les facteurs sociétaux et de gouvernance ; les sciences de l’environnement ; l’amélioration des performances énergétiques existantes ; le développement de l’écosystème et d’une économie verte.
De la cybersécurité technique aux politiques organisationnelles, en passant par la gestion des données et des risques, jusqu’à la réglementation de l’intelligence artificielle.
Cet axe rassemble les expertises et les projets de recherche orientés vers les politiques institutionnelles, les pratiques organisationnelles et les évolutions techniques liées au développement du numérique dans les différentes sphères de la société. De manière interdisciplinaire, cet axe touche à la gouvernance, à la gestion, à la circulation et à la sécurité de l’information. Plus spécifiquement, il regroupe les contributions dédiées à la cybersécurité ; à la gestion des données ; aux phénomènes informationnels liés au fonctionnement des médias ; à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la gestion des risques ; à la désinformation dans les espaces numériques ; aux compétences et pratiques numériques citoyennes ; à l’innovation technologique ; à la création et aux rôles des algorithmes ; ainsi qu’à la gestion et à la réglementation de l’intelligence artificielle et du cyberespace.
De la promotion au soutien et à la prévention de la santé en passant par l’émancipation des personnes, des familles et des collectivités tout en misant sur l’inclusion sociale.
Cet axe souhaite promouvoir, prévenir et soutenir la santé physique et mentale des personnes, des familles, des collectivités. Plus précisément, l’axe s’interroge sur : les actions éducatives favorisant l’émancipation ; l’éducation inclusive ; les pathologies diverses ; les technologies de la santé ; la santé des femmes ; la promotion de saines habitudes de vie ; le vieillissement de la population ; la santé publique et communautaire ; l’intervention, la thérapie et la réadaptation ; ainsi que les déterminants individuels et sociaux de la santé globale. L’axe vise plus concrètement à améliorer la qualité de vie des personnes et des collectivités en agissant sur les déterminants de la santé globale ; l’émancipation individuelle et collective ; ainsi que l’inclusion sociale. Il mobilise des approches interdisciplinaires en éducation, intervention, prévention et soutien, dans une perspective de justice en santé et de mieux-être social. Les initiatives portées encourageront les collaborations et les actions citoyennes pour améliorer le mieux-être collectif dans la perspective des Nations unies « Une seule santé ».
De la création et de la production de savoirs aux transformations sociales ; des institutions culturelles aux territoires et à une plus grande équité au sein des collectivités.
Cet axe contribue à la transformation sociale par la démocratisation des savoirs, la reconnaissance des cultures et la promotion de la justice sociale. Il s’appuie sur le développement citoyen, les productions artistiques et les connaissances portées par les individus, les institutions et les territoires. Les thématiques abordées incluent : l’impact de la production artistique contemporaine ; les enjeux muséaux et patrimoniaux ; le rôle du design urbain dans l’appropriation des espaces ; ainsi que les actions économiques, sociales, éducatives et culturelles contribuant au mieux-être collectif et au développement territorial. Il met de l’avant la participation citoyenne, la création artistique, la recherche engagée et les démarches de co-construction du sens collectif. Cet axe promouvra une plus grande équité et visera à mieux comprendre l’histoire et l’actualité de nos sociétés et de leurs profondes mutations.
3. Initiatives ciblées pour le développement de la recherche et de la création
Les initiatives présentées dans cette section découlent des travaux et recommandations du Groupe de travail. Elles visent à renforcer le fonctionnement des structures de la recherche et de la création à l’UQO, et ce, dans le souci de soutenir les projets et réalisations des quatre axes.
En guise de synthèse aux enjeux identifiés lors de la tournée des assemblées départementales et discutés lors des séances du Groupe de travail, trois tableaux des initiatives à entreprendre sont proposés, visant à faire progresser chacun des domaines identifiés au cours de la période d’exercice 2025–2030.
Ces initiatives sont regroupées selon six grandes thématiques listées sous trois tableaux :
→ Tableau 3.1. : Financement, programmes et initiatives stratégiques
→ Tableau 3.2. : Normes, processus, outils et infrastructures
→ Tableau 3.3. : Autres composantes du développement de l’écosystème de recherche
3.3.1. Développer la mobilité internationale et les échanges interuniversitaires en recherche et création
3.3.2. Institutionnaliser une culture d’innovation à l’UQO
3.3.3. Assurer une offre de formation, de mentorat et d’accompagnement en recherche et création
3.3.4. Accroître la mobilisation des connaissances, la visibilité des expertises en recherche et création et le soutien aux évènements de recherche et de création
Ces tableaux proposent une série d’objectifs et de sous-objectifs à entreprendre avec les acteurs concernés. Conformément aux principes SMART[11], les tableaux suggèrent les horizons de mise en œuvre ainsi que les indicateurs de résultats possibles pour en mesurer les retombées. Cette structuration vise à assurer un suivi fréquent et rigoureux. Cela en cohérence avec les grandes orientations institutionnelles et dans une logique d’amélioration continue du soutien à la recherche et à la création.
3.1. FINANCEMENT, PROGRAMMES ET INITIATIVES STRATÉGIQUES
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateur de résultat |
3.1.1. Adapter les opportunités internes de financement aux besoins de l’écosystème. | 3.1.1.1. Réviser et pérenniser les programmes internes du Fonds institutionnel du développement de la recherche et de la création (FIRC). | DRC / Commission des études / Comité de la recherche et de la création | En continu - À chaque budget | Une veille régulière de la pertinence des programmes du FIRC et une revalorisation de ceux-ci lorsque nécessaire. |
3.1.1.2. Améliorer la compréhension institutionnelle du fonctionnement des frais indirects de recherche et de la procédure de dérogation. | DRC / VRRCPI | Fin 2026 | Une directive définissant les frais indirects de recherche, placée sous la Politique de recherche et de création. | |
3.1.1.3. Mise en place d’un programme de chaires institutionnelles « UQO ». | DRC / VRRCPI | Fin 2026 | Une ou deux chaires estampées « UQO » à l’horizon fin 2026. | |
3.1.1.4. Favoriser l’accès aux bourses et aux subventions étudiantes. | DRC / Service aux étudiants / Décanat des études | 2027/2028 | Une meilleure visibilité interne des opportunités de bourses d’étude et de recherche pour les cycles supérieurs | |
3.1.2. Rechercher un financement externe durable, en appui aux projets de recherche et création de l’UQO | 3.1.2.1. Encourager les effets de levier, lorsque possible, et favoriser l’obtention de financements interuniversitaires prestigieux. | DRC / VRRCPI | En continu | Une augmentation continue du financement externe et des taux de succès aux principaux concours des organismes subventionnaires. |
3.1.2.2. Faciliter les perspectives de transition entre les cycles de financement des projets de recherche. | DRC / VRRCPI | En continu | Favoriser un maintien des unités de recherche et des fonds de celles-ci au fil du temps p. ex. dans la transition entre deux subventions CRSH ou CRSNG. | |
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateur de résultat |
3.1.3. Renforcer l’accompagnement pour le financement non traditionnel ou sectoriel | 3.1.3.1. Identifier des initiatives financières stratégiques pour chaque axe, tout au long de la période de réalisation de la planification quinquennale. | DRC / VRRCPI | En continu | À l’horizon 2030, un état du financement obtenu selon les axes stratégiques tout au long de la période d’exercice. |
3.1.3.2. Appuyer équitablement la préparation des demandes non traditionnelles de financement, notamment en création. | Équipe du DRC | En continu | Une diversification des candidatures présentées par l’UQO pour les projets de création, indépendamment des organismes subventionnaires de recherche. | |
3.1.3.3. Favoriser, lorsque possible, un lien avec la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais (FUQO) et la philanthropie. | DRC / FUQO | En continu | Un accroissement de la collaboration entre le DRC et la FUQO pour le montage du financement des projets de recherche et de création |
3.2. NORMES, PROCESSUS, OUTILS ET INFRASTRUCTURES
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateurs d’impact |
3.2.1. Appuyer la gestion des ressources contractuelles en recherche et création | 3.2.1.1. Favoriser l’agilité dans le recrutement des personnes assistantes et professionnelles de recherche, notamment par l’amélioration du processus de demandes de personnel. | DRC / Service des ressources humaines (SRH) / Vice-rectorat à l’administration et aux ressources (VRAR) | Fin 2026 - début 2027 | Une amélioration de la satisfaction des professeur·es à l’endroit de la gestion interne des demandes de personnel en recherche. |
3.2.1.2. Assurer une diffusion efficace des taux horaires et des conditions de la convention collective des étudiants syndiqués dans le cadre de la préparation des projets de recherche et création. | DRC / SRH | En continu | Une plus grande visibilité pour le corps professoral des taux horaires (incluant les charges sociales) à utiliser pour la préparation de leurs demandes de subvention (p. ex : communication annuelle dans l’infolettre, lors de l’accompagnement au pré-octroi). | |
3.2.2. Se doter des ressources numériques et technologiques nécessaires aux projets de recherche et de création | 3.2.2.1. Avoir un portrait plus précis des logiciels et bases de données nécessaires à l’écosystème et manquant à celui-ci. Assurer une offre de formations sur celles-ci. | DRC / Bibliothèque / Service des technologies de l’information (STI) / Centre de soutien et d’innovation en pédagogie universitaire (CSIPU) | En continu | Une veille des logiciels et de bases de données manquants à l’écosystème et régulièrement demandés par le corps professoral. Une offre de formation ou de ressources d’utilisation à déployer auprès de la communauté de recherche et de création de l’UQO. |
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateurs d’impact |
| 3.2.2.2. Assouplir, lorsque possible, les restrictions entourant le compte courriel, l’espace de stockage en ligne, les équipements informatiques et l’ajout de licences et logiciels sur les ordinateurs de recherche. | DRC / STI | Au courant de l’année 2026 | Une amélioration de l’agilité numérique pour la conduite des projets de recherche et de leurs acteurs (assistant.es et professionnel.les de recherche) |
3.2.3. Poursuivre l’accroissement de l’agilité de l’administration financière des projets de recherche | 3.2.3.1. Favoriser une accélération du traitement du remboursement des dépenses dans le cadre des projets. | DRC / Service des finances | En continu | Une réduction des délais et des approbations nécessaires, lorsque permise. |
3.2.3.2. Examiner la possibilité de limiter les quantités d’approbations financières en recherche par exemple, par la mise en place des ententes de préautorisation de dépenses. | DRC / Service des finances | 2027/2028 | Une plus grande facilité à recourir à une avance des dépenses par l’UQO, notamment dans le cadre des remboursements des frais de déplacements et de voyage (p. ex : réservations de vols, d’hébergement, etc.). | |
3.2.4. Adapter et mutualiser les espaces et les infrastructures de la communauté de recherche et de création. | 3.2.4.1. Revoir périodiquement les règles d’attribution des espaces de recherche afin de soutenir les besoins des unités et laboratoires de recherche et de création de l’UQO. | DRC / VRRCPI / Service des terrains et bâtiments (STB) / VRAR | En continu | Une veille annuelle entre le STB et le DRC de l’occupation des espaces et une révision si nécessaire, de la Directive sur les espaces de recherche et de création. |
3.2.4.2. Favoriser, lorsque possible, la mutualisation des équipements entre l’administration et les professeur·es chercheur·ses (p. ex. : flotte de véhicules de l’UQO). | DRC / VRRCPI / STB / VRAR | 2027/2028 | Création d’un inventaire des ressources disponibles et partageables pour les personnes chercheuses avec des procédures claires. |
3.3. AUTRES COMPOSANTES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateurs d’impact |
3.3.1. Développer la mobilité internationale et les échanges interuniversitaires en recherche et création | 3.3.1.1. Assurer une veille des financements tournés vers la recherche à l’international et une veille des exigences de mobilité internationale en recherche (p. ex. : visa, durée de séjour, etc.). | Direction des affaires internationales (DAI) / DRC | En continu | De l’information accessible sur les opportunités de financement et les règles de voyage transmise par le DAI et le DRC selon les canaux les plus pertinents. |
3.3.1.2. Faciliter le recrutement et l’accueil des personnes chercheuses invitées (personnes étudiantes, personnes postdoctorantes et professeur·es) afin d’assurer une meilleure intégration à nos systèmes et politiques (p. ex. : information sur les logements à moindre coût). | DAI / DRC | En continu | Une révision et une adaptation des procédures d’accueil et d’intégration des personnes chercheuses internationales invitées. | |
3.3.2. Institutionnaliser une culture d’innovation à l’UQO | 3.3.2.1. Favoriser le maillage à l’externe par la mise en relation des chercheur·ses avec les partenaires, particulièrement dans le développement d’ententes de collaboration. Accentuer la visibilité de l’UQO et de ses unités de recherche auprès des acteurs publics et privés de l’innovation dans le cadre du service à la collectivité. | DRC / VRRCPI / Direction des communications et du recrutement (DCR) | En continu | Une plus grande visibilité sur le site de l’UQO de nos unités de recherche et de leurs réalisations et collaborations. Une poursuite des efforts de structuration de l’offre d’accompagnement des partenariats et ententes de recherche. |
3.3.2.2. Développer une meilleure compréhension des règles et des procédures de valorisation de la propriété intellectuelle auprès notamment des personnes étudiantes, postdoctorantes et chercheuses régulières pour offrir un meilleur accompagnement en la matière. | DRC / VRRCPI / Secrétariat général | En continu | Intellectualisation de la Politique et règles en matière de gestion de la propriété intellectuelle de l’UQO à l’horizon 2027-2028. |
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateurs d’impact |
| 3.3.2.3. Renforcer l’entrepreneuriat académique, tant chez les personnes étudiantes que chez les professeur·es, notamment en se rapprochant, lorsque pertinent, des incubateurs régionaux en Outaouais et dans les Laurentides. | DRC / Directions de recherche / Décanat des études / Services aux étudiants | En continu | Une augmentation, par les canaux de communication internes, de la visibilité des opportunités entrepreneuriales liées à la recherche auprès des personnes chercheuses et étudiantes de l’UQO. |
3.3.3. Assurer une offre de formation, de mentorat et d’accompagnement en recherche et création | 3.3.3.1. Assurer la formation des acteurs de l’écosystème autres que les professeur·es : personnes étudiantes, personnes professionnelles et auxiliaires de recherche. | DRC / CSIPU / Bibliothèque | En continu | Assurer sur une base annuelle une programmation de formations ou d’ateliers destinés à l’écosystème de recherche et de création de l’UQO avec les services concernés. |
3.3.3.2. Veiller à garantir un continuum de formation de mentorat et d’accompagnement tout au long de la carrière en recherche et création : accueil des nouvelles ressources professorales et postdoctorales ; relance de la carrière à l’issue d’un congé ; formation sur les subventions pour toutes les personnes chercheuses, y compris celles qui sont les plus avancées dans leur carrière ; etc. | DRC / Décanat de la gestion académique (DGA) | 2028-2029 | Une liste de ressources visibles et thématiques sur le portail des employés et sélectionnées conjointement par le DGA et le DRC pour appuyer les enjeux de gestion de la carrière en recherche à différentes étapes et selon le statut (démarrage, relances, retraite). | |
3.3.3.3. Miser sur un mentorat « par et pour » les pairs avec des regroupements internes d’appartenances en recherche (p. ex. Collège des chaires de recherche du Canada, Communauté de pratique des nouvelles personnes en recherche, titulaires d’une chaire UQO, etc.). | DRC et VRRCPI | 2026-2027 | Des communautés d’appartenance identifiées et formalisées avec une interaction fréquente de ses membres. | |
Initiatives retenues | Sous-objectifs | Acteurs clés | Horizon de mise en œuvre | Indicateurs d’impact |
| 3.3.3.4. Réviser le cadre postdoctoral pour plus de flexibilité dans la définition d’un contrat postdoctoral (p. ex : en favorisant un postdoctorat à mi-temps). | DRC et VRRCPI | 2026-2027 | Une mise à jour de l’énoncé de la Politique d’accueil et d’encadrement des personnes stagiaires postdoctorales. |
3.3.4. Accroître la mobilisation des connaissances, la visibilité des expertises en recherche et création et le soutien aux évènements de recherche et de création | 3.3.4.1. Poursuivre l’appui à l’organisation interne d’évènements et d’activités de recherche et de création et notamment dans le cadre de la Semaine de la recherche. | DRC / VRRCPI / DCR | En continu | Une augmentation de la perception des efforts et du soutien à l’endroit de l’organisation des évènements internes en recherche. |
3.3.4.2. Développer et améliorer l’offre d’appui à la promotion des expertises en recherche et création de l’UQO : page personnelle, communication des succès, présence dans les médias, répertoire interne des sujets d’expertises ou des vidéos promotionnelles sur nos chercheur·ses et sur nos axes. | DRC / VRRCPI / DCR / Bibliothèque / STI | 2028-2029 | Une révision des outils promotionnels internes des expertises en recherche et création et une adaptation de ceux-ci aux meilleures pratiques. | |
3.3.4.3. Poursuivre les efforts de sensibilisation en faveur de la science ouverte et de la diffusion des meilleures pratiques autour du libre accès et de la gestion sécurisée des données de recherche sur le long terme, sans oublier les questions liées à l’intégration de l’intelligence artificielle en recherche et création. | DRC / Bibliothèque / STI | En continu | Une augmentation des publications en libre accès à l’UQO et du nombre de demandes d’archivage des données de recherche dans le portail institutionnel Boréalis.
Une meilleure compréhension interne des usages de l’IA en recherche et création. |
RÉFÉRENCES
[1] UQO (2022). Plan stratégique institutionnel 2022-2026. https://uqo.ca/planification-strategique-2022-2026.
[2] Par exemple, dans le cadre des programmes offerts par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada pouvant impliquer nos professeur·es.
[3] L’UQO, à titre d’université de région, est membre du regroupement The Alliance of Canadian
Comprehensive Research Universities (ACCRU) qui représente les universités qui ne figurent pas dans les établissements membres du U15.
[4] Université du Québec. (2024, 6 mai). Lettre ouverte — Financement fédéral de la recherche : une concentration qui nuit aux collectivités locales. https://reseau.uquebec.ca/fr/a-propos/salle-depresse/actualites/lettre-ouverte-financement-federal-de-la-recherche.
[5] Groupe sur la conduite responsable de la recherche (2023, 18 mai). Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche (2021) (publication no RR4-2/2023F-PDF). Gouvernement du Canada. https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre-2021.html.; Fonds de recherche du Québec (2022, 1er novembre). Politique sur la conduite responsable en recherche. Gouvernement du Québec. https://frq.gouv.qc.ca/politique-sur-la-conduite-responsable-en-recherche/?preview=true.
[6] Conformément à l’article 5.04 de la Convention collective de travail entre l’UQO et le Syndicat des professeures et professeurs de l’UQO (SPUQO) 2022-2026.
[7] Bourdieu, P. (2001). Science de la science et réflexivité. Raisons d’agir.
[8] Selon les principes des données « FAIR » (Statistique Canada, 2022).
[9] Pour en apprendre davantage sur les mécanismes d’accompagnement et de révision des demandes de subvention offerte, visitez le site web du Décanat.
[10] Conformément à la Politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) de l’UQO et au plan stratégique ÉDI, en particulier en ce qui a trait à son axe 2 pour le milieu de recherche et de création.
[11] SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis.