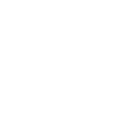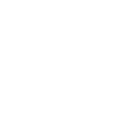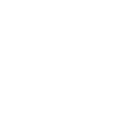Démocratiser la finance pour démocratiser le travail : passé, présent et avenir au Québec
Descriptif général
La discipline qu’impose le capital financier aux entreprises, aux ménages salariés et aux États creuse les inégalités sociales et accélère la crise écologique. Devant ce constat, la recherche d’alternatives financières fait l’objet d’une attention renouvelée, par exemple pour relever les défis de financement d’une transition écologique juste. Comme source d’inspiration, le Québec a souvent été vu comme abritant un écosystème financier public, coopératif et syndical plus démocratique qu’ailleurs en Amérique du Nord. Or, l’évaluation des rôles et des limites de ces institutions financières ne fait pas consensus.
Cette série de trois conférences vise à créer un espace fécond de débat portant sur l’émergence, les transformations, les impacts socioéconomiques et écologiques et la démocratisation économique des innovations financières créées depuis les années 1970 au Québec. Les analyses des relations financières entretenues par différentes institutions financières avec le monde du travail, et plus spécifiquement, avec les expériences de coopératives de travailleurs et travailleuses, seront privilégiées. La première séance va porter sur les institutions pionnières de la finance socialement responsable (FSR) au Québec alors que la deuxième favorisera un dialogue entre différentes perspectives afin de dresser un bilan critique de l’histoire de la FSR. À partir des limites et des contradictions financières identifiées précédemment, la dernière conférence privilégiera les réflexions prospectives de démocratisation de la finance adaptée aux défis socio-écologiques du 21e siècle.
Ces activités se veulent des séminaires préparatoires au colloque international « LES FIBRES DE LA SOLIDARITÉ L’autogestion au travail, 50 ans après Tricofil : leçons, inspirations et comparaisons », organisé par le Pôle UQO du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), du 4 au 6 mars 2026 à Saint-Jérôme.
Séminaire I. Des défis financiers de l’autogestion aux innovations financières après Tricofil
…le ministre Saint-Pierre a fini par dire que, même s’il était responsable de la bonne gestion des fonds publics, il avait autorisé la Société de développement industriel à nous prêter 300 000$, tout en croyant que ce prêt serait une perte totale. Dans notre tête, le Ministre venait de nous dire, à ce moment-là, qu’il nous avait donné juste assez de corde pour nous pendre, mais pas assez pour que notre projet réussisse.
Paul-André Boucher, Tricofil, tel que vécu (1982 : 146-47)
Descriptif :
L’expérience de Tricofil a soulevé l’importance de l’enjeu de la démocratisation de la finance pour le mouvement syndical. Compte tenu de l’intégration de Tricofil au sein de relations étatiques et financières contraignantes, la gestion traditionnelle et la recherche de la rentabilité vont l’emporter sur le projet collectif (Boucher 1982). Alors que Tricofil demeurera soumise à des pressions concurrentielles exacerbées par des relations financières « traditionnelles », cette expérience va se terminer de manière contraire aux aspirations de départ.
Cette conférence vise, tout d’abord, à mettre en lumière les impacts socioéconomiques des relations contractées par Tricofil avec différentes institutions financières publiques (Société de développement industriel), « coopératives » (Desjardins) et privées (Banque Scotia). Ensuite, il s’agira d’explorer comment l’expérience de Tricofil et son issue ont influencé la création de nouvelles institutions financières au Québec à partir des années 1980. Cette première conférence d’une série de trois va s’attarder principalement au contexte de création des institutions financières à l’étude et de leurs rôles dans le développement socioéconomique du Québec.
Date : 30 octobre 2025
Heure : 12h – 13h30
Lieu : sur zoom (s’inscrire en cliquant ici pour recevoir le lien) https://uqam.zoom.us/meeting/register/eKJRHwuTSne0fZJqOh-N3g
Avec :
Paul-André Boucher, ouvrier et directeur de Tricofil, ouvrier militant de la coopération
Michel Blondin, formateur syndical au Fonds de solidarité FTQ
Pierre-Olivier Maheux, historien du Mouvement Desjardins
Animation : Marie-Pierre Boucher, professeure de Relations industrielles à l’UQO et membre du comité d’organisation du colloque Tricofil