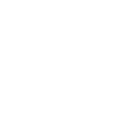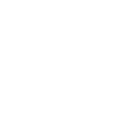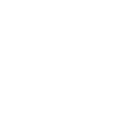Le bien-être au travail au cœur des recherches de Martin Lauzier

Chaque mois découvrez le portrait d’un.e chercheur·.se de l’Université du Québec en Outaouais.
Ce mois-ci, place à Martin Lauzier, psychologue du travail et professeur au Département de relations industrielles. À travers ses réponses, il nous partage sa passion pour la compréhension des dynamiques humaines au sein des organisations et l’importance du bien-être collectif au travail.
Quel a été l’élément déclencheur qui vous a amené à choisir votre domaine de recherche?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été passionné par le sport, que ce soit à travers la pratique de sports d’équipe ou de compétition. Rapidement, j’ai été fasciné par ce qui se passe au-delà du jeu lui-même : pourquoi certaines équipes réussissent mieux que d’autres? Qu’est-ce qui favorise la cohésion? Qu’est-ce qui distingue un bon leader?, etc.
Au fil du temps, ces questions ont naturellement migré du terrain à l’organisation. En effet, réduite à son expression la plus simple, une organisation n’est souvent rien d’autre qu’un regroupement d’équipes aux rôles, aux objectifs et aux dynamiques multiples.
C’est lors de mon parcours universitaire en psychologie, plus précisément vers la fin de mon baccalauréat, que j’ai découvert le champ de la psychologie du travail et des organisations (aussi appelé psychologie industrielle/organisationnelle). Ce fut une véritable révélation! J’ai immédiatement su que c’était là que je voulais concentrer mes énergies et mes recherches.Qu’est-ce qu’un psychologue du travail?
Souvent moins connu que ses homologues, le psychologue du travail est un membre à part entière de la grande famille de la psychologie. Ce qui le distingue, c’est avant tout son champ d’application : alors que d’autres approches se concentrent sur l’individu en tant que tel, le psychologue du travail adopte une perspective résolument organisationnelle. Son regard se centre plutôt sur l’analyse des dynamiques humaines qui surviennent et évoluent dans les milieux professionnels.
Dans un monde du travail en constante transformation — marqué par la complexité, l’incertitude, les évolutions technologiques et les nouvelles attentes des travailleurs — le psychologue du travail observe, analyse et intervient sur ces dimensions afin d’aider les organisations à mieux fonctionner, tout en favorisant le bien-être de leurs membres.
Qu’il s’agisse de mieux structurer les équipes, de prévenir les risques psychosociaux, d’accompagner une organisation dans un changement ou de simplement travailler à l’optimisation des pratiques existantes, il agit comme un conseiller stratégique ancré dans la réalité humaine de l’organisation.Vous êtes spécialiste en psychologie du travail. Quels seraient vos trois meilleurs conseils pour une personne qui cherche à améliorer son bien-être et sa qualité de vie au travail?
Je me permets de reformuler légèrement votre question, en remplaçant le mot « personne » par « organisation ». Car si la quête du bien-être est d’abord et avant tout une démarche dite individuelle, cet état ne peut véritablement s’épanouir — dans un milieu de travail — sans que les conditions qui facilitent son émergence soient présentes.Repenser la qualité du travail, pas seulement sa quantité. Le bien-être au travail ne dépend pas seulement de la charge ou du rythme, mais aussi et surtout de la nature même du travail effectué par une personne. Les recherches montrent depuis longtemps déjà que les employés sont plus engagés (et plus heureux) lorsqu’ils perçoivent leur travail comme significatif, utile et valorisé.
Favoriser l’autonomie et la confiance. Un climat de confiance, où l’on accorde une réelle autonomie aux individus et aux équipes, est selon moi un autre pilier fondamental du bien-être au travail. Cela suppose de déléguer intelligemment, de valoriser les compétences, mais aussi de favoriser l’établissement d’un climat sécuritaire, c’est-à-dire un climat où l’on peut s’exprimer, expérimenter et parfois même se tromper — sans peur d’être jugé.
Faire du bien-être une responsabilité partagée. Le bien-être au travail ne peut reposer uniquement sur des initiatives individuelles; il doit faire partie intégrante de la stratégie de l’organisation. Cela implique que les gestionnaires, les RH et les équipes de direction reconnaissent le rôle actif qu’ils peuvent (voire doivent) jouer pour créer des conditions de travail saines, soutenantes et humaines.
Quelle recommandation donneriez-vous à une personne qui envisage une carrière en recherche?
On dit souvent — en blaguant — que le métier de professeur-chercheur est le plus beau métier du monde, du fait qu’il permet de choisir librement quand faire ses 72 heures par semaine. Au-delà de l’humour, j’estime que cette phrase illustre bien l’idée voulant que la recherche soit un engagement de tous les instants, qui demande donc une discipline personnelle solide.
Évidemment, les conseils que je peux donner s’inspirent de mon propre parcours et ne peuvent en rien s’interpréter comme des lois universelles, mais si je devais en formuler quelques-uns, voici ceux que je retiendrais :Lire abondamment… et stratégiquement. La lecture est l’outil premier du chercheur. Il ne s’agit pas seulement de lire dans son champ précis, mais aussi de rester curieux des disciplines connexes. Beaucoup d’idées novatrices émergent à l’intersection des savoirs.
Adopter une posture d’apprentissage continu. Être chercheur, c’est accepter de ne jamais avoir complètement fini d’apprendre. Comme spécialiste de la formation et du transfert des apprentissages, j’estime essentiel de planifier — intentionnellement — des moments pour se former, se mettre à jour ou explorer de nouveaux outils, et ce, même en dehors de son domaine immédiat.
Se rapprocher du terrain — et y retourner souvent. Ce dernier conseil vaut sans doute aussi pour d’autres disciplines que la mienne : multiplier les occasions de se confronter aux réalités concrètes du terrain. Le fait de provoquer de tels rapprochements permet non seulement de mieux comprendre les enjeux vécus par les individus et les organisations, mais aussi de vérifier la pertinence et l’utilité sociale de nos travaux.
Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur votre champ d’expertise, auriez-vous un livre ou une ressource à recommander?
Au Québec, un excellent point de départ serait la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations (SQPTO). Cet organisme regroupe les psychologues du travail de la province et joue un rôle central dans la valorisation de la profession et la création de liens entre le milieu académique et le terrain. La SQPTO organise régulièrement des activités, des colloques et des conférences dans plusieurs régions du Québec — y compris ici en Outaouais, où un chapitre régional bien actif propose des événements depuis plusieurs années déjà à l’UQO.
Côté lecture, je peux recommander le livre A Brave New Workplace de Julian Barling, qui expose avec beaucoup de clarté les liens probants qui existent entre leadership, transformation organisationnelle et bien-être durable. Pour celles et ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur le champ de la psychologie du travail, je suggère aussi l’ouvrage de Roland Foucher et François Leduc intitulé Domaines de pratique et compétences professionnelles des psychologues du travail et des organisations.
À lire aussi
Dans le cadre de son programme de recherche, le professeur Martin Lauzier, du Département de relations industrielles, et son équipe ont obtenu une subvention de 305 000 $ de la part de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
Cette subvention soutiendra un projet portant sur les formations visant à prévenir les phénomènes de violence en milieu de travail, en particulier dans le secteur de la santé.
→ En savoir plus