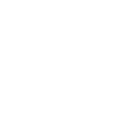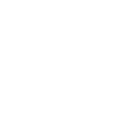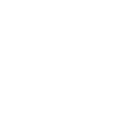Domaines d'études:
Admission
Études à l’UQO
- Études de premier cycle
- Modules et unité de gestion des études
- Programmes contingentés
- Reconnaissance des acquis
- Stages rémunérés coopératifs
International
Finances
Vie sur le campus
Domaines d'études:
Admission
Études à l’UQO
Recherche et création
International
Finances
Vie sur le campus
Admission
Étudier à l’UQO
- Événements et nouvelles
- Programmes d'études
- Horaire des cours
- Inscription
- Études hors établissement
- Frais de scolarité
- Calendriers universitaires
- Carte d’identité
- Soutien à l'apprentissage et à la réussite (CSIPU)
- Protection des stagiaires
- Collation des grades
Financer vos études
Employés de l'UQO
- Nouvelles et évènements
- Décanat de la gestion académique
- Service des ressources humaines
- Liste des formulaires
Les catégories d'employés
Notre personnel retraité
- Association des retraités
- Personnel retraité
- Avantages des retraités
- Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ)
Les politiques, procédures et règlements
Les avantages sociaux et programmes
- Les assurances collectives
- Les régimes de retraites
- Le programme d'accès à l'égalité en emploi
- Le programme d'aide aux employés
- Le programme d'équité salariale
- Le programme de mobilité (réseau UQ)
- Le programme de santé et mieux-être
- Le programme de REER collectif
- Le programme de préparation à la retraite
- Le programme de développement des compétences