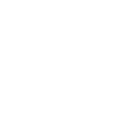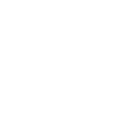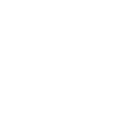Les femmes perçoivent l’expression de douleur différemment, ce qui leur confère un avantage
Une nouvelle étude menée par Marie-Pier Plouffe-Demers sous la direction de la professeure Caroline Blais et du professeur Daniel Fiset, du Laboratoire de perception visuelle et sociale de l’UQO, suggère une explication à l’avantage qu’ont les femmes à reconnaitre et évaluer les émotions et la douleur vécue par autrui.
« Plusieurs cadres théoriques ont tenté d’expliquer les différences sexuelles dans la reconnaissance d'expression faciale d’émotion, nous on a voulu vérifier si les femmes utilisaient des informations du visage différentes de celles utilisées par les hommes », explique mentionne Marie-Pier Plouffe-Demers, auteure principale de l’article et candidate au doctorat au Laboratoire de perception visuelle et sociale de l’UQO.
Madame Plouffe-Demers est également chargée de cours au Département de psychoéducation et de psychologie. L'article en anglais intitulé Facial expression of pain: Sex differences in the discrimination of varying intensities dans le numéro de septembre de la revue Emotion
Facial expression of pain: Sex differences in the discrimination of varying intensities
Écoutez l'entrevue de Marie-Pier Plouffe-Demers à l'émission Les Matins d'ici
En comparant les zones du visage utilisées par les hommes et les femmes pour discriminer des intensités d’expressions faciales de douleur variables, cette étude soulève deux différences dans les stratégies visuelles empruntées. Premièrement, les femmes sont plus efficaces pour discriminer les intensités d’expressions, elles ont besoin de moins d’information visuelle que les hommes. Deuxièmement, elles vont s'appuyer sur de plus larges régions du visage que leurs homologues masculins.
« Deux hypothèses pourraient expliquer ces résultats : 1) soit les femmes sont capables d’intégrer plus efficacement de l'information provenant de différentes zones du visage donc en quelque sorte traiter le visage dans sa globalité, 2) soit elles sont plus flexibles dans l'utilisation des informations présentes dans ces régions-là. Dans ce cas-là, si une partie du visage n’est pas accessible elles pourront en utiliser une autre presque aussi efficacement. »
Les femmes opteraient alors pour un traitement plus holistique ou flexible des informations faciales, tandis que les hommes s'appuieraient sur une stratégie d'intégration spécifique, mais rigide.
“Maintenant on sait que les hommes et les femmes traitent le signal émotionnel différemment, mais on aimerait savoir si ces différences perceptives ont des bases biologiques (innées) ou si elles sont acquises au fil de notre développement. Par exemple, il se pourrait que le dysmorphisme sexuel, notamment la taille de notre cortex visuel (le cortex visuel étant en général plus petit chez la femme), nous mène à voir le monde différemment. Il se pourrait aussi que ce soit une question de socialisation des enfants. Par exemple, il a été démontré que les parents tendent à utiliser un langage plus émotionnel avec leurs filles qu’avec leurs garçons, ce qui pourrait favoriser chez les femmes un intérêt et une expertise pour les informations visuelles qui leur semblent les plus adaptative, comme dans ce cas-ci les expressions faciales d’émotion.”
À propos de l’étude
Marie-Pier Plouffe-Demers, auteur principal de l’article, ses directeurs de recherche, la professeure Caroline Blais et le professeur Daniel Fiset ainsi que leurs collaborateurs Camille Saumure et la professeure Stéphanie Cormier ont publié l’article Facial expression of pain: Sex differences in the discrimination of varying intensities dans le numéro de septembre de la revue Emotion [PDF]. Marie-Pier Plouffe-Demers est candidate au doctorat à l’Université du Québec à Montréal. Camille Saumure, ancienne étudiante du LPVS, est maintenant étudiante au doctorat à l’Université de Fribourg. Caroline Blais, Daniel Fiset et Stéphanie Cormier sont professeurs au Département de psychologie et psychoéducation de l’Université du Québec en Outaouais. Caroline Blais est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en vision cognitive et sociale.
Le 26 septembre 2022