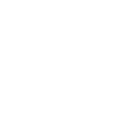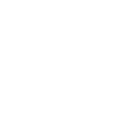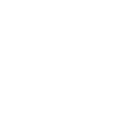Table ronde de la Chaire Senghor de la Francophonie : un moment exceptionnel de partage d’expériences
La conférence-table ronde organisée par la Chaire Senghor de la Francophonie de l’UQO, dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, le 11 novembre dernier, a connu un éclatant succès tant par les compétences mobilisées que par la participation à grand nombre du public.
Il faut dire que la thématique proposée (récits de résistance et d’espoir : femmes et luttes agroécologiques) laissait augurer des débats passionnés enrichis par les expériences personnelles des panélistes. Ces dernières ont généreusement partagé leurs expériences de vie et ont échangé de façon libre et souvent non formalisé avec un public curieux et attentionné.
Après le mot d’ouverture du professeur Ndiaga Loum, titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de l’UQO, qui a insisté sur l’importance pour les universités de collaborer avec les communautés destinataires principales des recherches scientifiques, la table-ronde a donné lieu à des débats autour de l’ouvrage de Mariam Sow, figure majeure du mouvement paysan et féministe en Afrique. Le livre intitulé Loumbi Nguido - La paysanne a fait l’objet d’un échange nourri entre l’auteure et Monsieur Éric Chaurette de l’organisation Inter-pares.

Une opportunité saisie pour revenir sur les conséquences pernicieuses de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture et sur les nécessités de revenir à une agriculture plus écologique et responsable qui respecte l’expertise originale et empirique des premiers concernés, les paysans. Le livre de madame Sow est le condensé d’une vie de combat d’une militante écoféministe qui est passée à l’étape d’enseigner à la jeune génération tous les savoirs théoriques et pratiques engrangés.
Dans cette vie de combat, elle a obstinément et minutieusement franchi, tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, laissant poindre l’espoir de voir un jour rééclore une agriculture responsable et écologique. Avant le démarrage de la table ronde portant sur les récits d’espoirs et de résistances des panélistes, la parole a été respectivement donnée à Dieynaba Tall de l’organisation Inter Pares, Jean Michel Sène (Secrétaire exécutif d’Enda Pronat) et Annick Brazeau qui ont tour à tour présenté les missions et objectifs de leurs organismes et expliqué la particularité de la programmation et du thème retenu pour l’année 2025, des journées québécoises de la solidarité internationale.

Enfin, durant près de deux tours d’horloge, nos trois pénalistes, Monique Bisson (militante québécoise engagée pour l’agriculture durable), Odette Sarr (militante pour la défense des savoirs paysans et des droits des femmes) et Mariam Sow (présidente d’Enda Pronat), ont tenu en haleine le public. Les expériences vécues, racontées ou partagées ont laissé à la fois exploser des émotions positives et suscité des réflexions critiques qui ont inspiré le public qui n’a pas été en reste.
Ce dernier a saisi l’occasion pour exprimer des préoccupations quant à la détérioration progressive de l’environnement, la réduction des surfaces emblavées, les maladies découlant de l’usage des produits toxiques utilisés dans les espaces agricoles, l’impuissances des pouvoirs publics surtout dans les pays du Sud face à la pression des multinationales agro-alimentaires, l’implication des femmes dans la gestion et la protection des ressources naturelles, l’écoféminisme, etc. Sur ces questions, paysans du Sud et du Nord font face aux mêmes défis et ont le devoir solidaire d’unir leurs forces pour faire face.
Sur chacune de ces questions, nos panélistes ont apporté des réponses précises qui ne laissent aucun doute sur la maitrise des sujets abordés et le sens de leur engagement. Empathie, générosité, passion et authenticité sont les traits communs de nos trois conférencières. À la fin des échanges, la professeure Audrey Rousseau, co-organisatrice de l’événement et qui a déplacé en salle de conférence son cours sur « l’interculturalité et le développement », a offert une excellente synthèse des débats, pointant des enseignements particulier et généraux à tirer de chacune des interventions.
« Cet événement est la preuve vivante que l’Université et les communautés doivent échanger et cheminer ensemble vers le progrès. Les moyens de faire sont certes limités mais l’horizon de nos collaborations respectives est quant à lui infini » conclut le titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie, Ndiaga Loum.
Le 17 novembre 2025