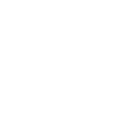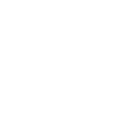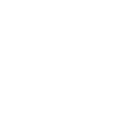Redéfinir le « faire famille » avec Isabel Côté

Chaque mois, découvrez le portrait d’un.e chercheur.se de l’UQO. Ce mois-ci, place à Isabel Côté, professeure titulaire au Département de travail social et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Ses recherches portent sur la procréation pour autrui et les dynamiques familiales non traditionnelles. À travers ses travaux, elle explore la manière dont les parcours parentaux se construisent collectivement et comment les normes sociales façonnent ces expériences.
1. Quel a été l’élément déclencheur qui vous a amenée à choisir votre domaine de recherche?
Mon intérêt pour mon champ de recherche est né au moment de ma thèse de doctorat, alors que je me suis intéressée aux mères lesbiennes ayant eu recours à un donneur de sperme connu, à savoir un homme de leur entourage ayant accepté de contribuer à leur projet parental, sans être légalement reconnu comme père. J’ai cherché à comprendre ce qui motivait ces femmes à choisir cette voie plutôt que d’opter pour un donneur via une banque de sperme et ce qui amenait ces hommes à s’impliquer dans la conception d’un enfant qui ne serait pas le leur juridiquement.
J’ai ensuite voulu saisir comment les enfants issus de ces projets percevaient la place de ce donneur dans leur vie. J’ai documenté leur regard sur la relation qu’ils entretenaient – ou non – avec lui, et la manière dont ils comprenaient le rôle qu’il avait pu jouer dans leur conception. Enfin, j’ai examiné comment les partenaires de vie de ces donneurs s’inscrivaient dans cette dynamique.
À cette époque, le Québec venait d’adopter la Loi instituant l’union civile et les nouvelles règles de filiation, laquelle a permis à des couples gais et lesbiens de fonder une famille sur la base de leur projet parental, qu’il s’agisse d’adoption ou de procréation assistée. Elle a toutefois suscité de vifs débats : certain.es y ont vu une remise en question de la filiation biologique, d’autres craignaient que ces nouvelles configurations parentales ne compromettent le meilleur intérêt de l’enfant.
Ayant moi-même grandi dans une famille considérée comme non normative dans les années 1970-1980, j’ai vite compris que les représentations sociales de la famille ne traduisent pas toujours la réalité vécue par certaines ou certains d’entre nous. C’est ce qui m’a conduite à m’intéresser à cette modalité familiale dans le cadre de ma thèse, puis, plus largement, à celles qui découlent du recours à la procréation pour autrui – qu’il s’agisse d’un donneur ou d’une donneuse de gamètes ou d’embryons, ou encore d’une femme porteuse.
Je m’intéresse ainsi à la manière dont les normes façonnent l’expérience des personnes concernées par des formes non traditionnelles de procréation mais également aux stratégies qu’elles adoptent pour s’y conformer, s’en distancier ou les réinterpréter. Je considère la procréation pour autrui non comme un phénomène uniforme régi uniquement par des normes externes, mais comme un processus dynamique où les individus interagissent avec les structures qui les entourent, redéfinissant ainsi, à travers leurs pratiques et leurs récits, ce que signifie « faire famille ».
2. Pourquoi ce champ d’études vous passionne-t-il particulièrement?
La procréation pour autrui me passionne parce qu’elle interroge profondément notre manière de concevoir la famille, la filiation et la parentalité. Elle multiplie les contributions nécessaires à la conception d’un enfant, ouvrant à la possibilité de projets parentaux collectifs, où plusieurs personnes participent à la naissance d’une même histoire familiale.
Réaliser un projet parental à l’aide d’une tierce partie transforme ainsi notre compréhension de la reproduction et des liens qui en découlent, tout en remettant en cause les représentations traditionnelles et cishétéronormatives de la parenté, fondées sur la reproduction biologique.
Je trouve tout aussi fascinant d’analyser les représentations des liens familiaux qui émergent dans ces contextes. Elles questionnent les fondements mêmes de ce qui crée le lien entre les membres d’un système familial. Par exemple : deux enfants portés par la même femme, mais issus de patrimoines génétiques distincts se considèrent-ils comme frère et sœur?
Ce champ d’étude est d’autant plus intéressant qu’il met en tension des dimensions éthiques, sociales, féministes et juridiques et nous invite à réfléchir à l’autonomie et à l’agentivité reproductive des personnes concernées, au bien-être des enfants et aux dérives possibles de certaines pratiques.
Mes recherches me conduisent à observer comment les connexions découlant d’un don de gamètes, d’embryons ou d’une grossesse pour autrui dépassent la seule relation entre l’enfant et le tiers de procréation et peuvent s’étendre à un réseau plus vaste, incluant la famille de ce tiers et parfois d’autres enfants également issus de lui. La génétique agit ici comme un canal potentiel de parenté à partir duquel se tisse un ensemble de liens nouveaux. La procréation pour autrui devient ainsi un espace vivant où se reconfigurent les contours du « faire famille ».
3. Vous vous intéressez aux projets parentaux qui s’actualisent grâce à l’apport d’autrui. Quels seraient vos trois meilleurs conseils pour favoriser des milieux de travail plus inclusifs et sensibles à la diversité des parcours familiaux?
Pour que les milieux de travail soient réellement inclusifs et sensibles à la diversité des parcours familiaux :
Adapter les conventions collectives aux réalités familiales d’aujourd’hui.
Par exemple, malgré la réforme du Régime québécois d’assurance parentale, certaines conventions collectives maintiennent une disparité entre les mères biologiques qui accouchent de leurs enfants et les autres parents. Les premières bénéficient de semaines supplémentaires de congé liées à leur rétablissement postnatal, tandis que les seconds ne peuvent y avoir accès. Ce déséquilibre crée non seulement une inégalité entre les parents, mais aussi entre les enfants. Reconnaître l’égalité des enfants, quelle que soit la manière dont ils sont venus au monde, devrait être au cœur des préoccupations des employeurs.Rendre visible la diversité familiale.
Représenter différentes configurations – familles LGBTQ+, recomposées, adoptives, etc. – dans les communications, les activités de valorisation ou les politiques internes témoigne concrètement de l’engagement d’un milieu envers l’inclusion. La visibilité n’est pas qu’un geste symbolique : elle a un effet concret sur le sentiment d’appartenance et de légitimité des personnes concernées.Former et sensibiliser les gestionnaires et les équipes.
Comprendre les réalités des familles contemporaines, les termes appropriés à utiliser, les besoins particuliers liés à certaines trajectoires parentales ou encore les biais inconscients qui peuvent s’exprimer au quotidien permet d’ancrer durablement la culture de l’inclusion. Ces discussions encouragent l’empathie, préviennent les maladresses et favorisent des environnements de travail où chacun se sent reconnu dans sa réalité familiale.
4. Quelle recommandation donneriez-vous à une personne qui envisage une carrière en recherche dans le domaine du travail social?
Faire de la recherche en travail social, c’est avant tout s’inscrire dans une démarche guidée par les valeurs qui fondent la discipline : justice sociale, solidarité et respect de la dignité humaine.
Ainsi, le travail social place la pertinence sociale au cœur de la production de connaissances. Il ne s’agit pas seulement d’observer un phénomène, mais de comprendre les réalités vécues et de soutenir des transformations collectives.
Pour cela, il importe :
de veiller à l’ancrage social de son projet;
de travailler en partenariat avec les milieux de pratique, les organismes communautaires ou les groupes citoyens;
de co-construire les objectifs de recherche et de s’assurer que les retombées soient tangibles pour les actrices sociales et les acteurs sociaux.
Je considère également qu’il faut oser occuper l’espace public et politique. Les chercheuses et chercheurs en travail social ont un rôle important à jouer pour faire entendre la voix des populations marginalisées et pour que les données probantes éclairent les politiques publiques. Cela suppose de cultiver des liens avec les décideurs et de s’exprimer dans les forums où se façonnent les choix collectifs.
Enfin, la diffusion des savoirs est essentielle. Publier dans des revues scientifiques demeure important, mais il faut aussi privilégier des canaux accessibles aux milieux de pratique et au grand public. Contribuer aux débats sociétaux, vulgariser les résultats et les rendre mobilisables fait partie intégrante de la responsabilité sociale de la recherche en travail social.
5. Pour les membres de la communauté universitaire qui souhaiteraient approfondir ces questions, y a-t-il un livre, une ressource ou une initiative que vous recommanderiez?
Je recommande particulièrement le livre Familles queers : récits et célébrations, de Marianne Chbat (Les Éditions du Remue-Ménage, 2024).
Ce livre offre un regard actuel, nuancé et ancré dans la communauté sur les réalités familiales LGBTQ+, en tenant compte des avancées sociales et juridiques autant que du ressac réactionnaire contemporain. À travers une trentaine de témoignages intimes, l’ouvrage met en lumière la résilience, la créativité et l’agentivité des familles queers, ainsi que les embûches et deuils qu’elles traversent.
En présentant des expériences diverses, il permet de mieux comprendre les enjeux spécifiques liés aux structures familiales queers, aux stigmates persistants et aux stratégies de résistance. Sa construction en collaboration avec le milieu communautaire en fait un outil authentique et représentatif, essentiel pour développer des pratiques sensibles, inclusives et ancrées dans les réalités vécues des personnes LGBTQ+.
Pour en savoir plus
La professeure Isabel Côté signe quatre nouvelles capsules vidéo sur le don de gamètes diffusées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.
Le MSSS publie ces capsules dans la foulée des recommandations formulées par le Comité central d'éthique clinique en procréation médicalement assistée. Le comité avait pour mandat de recommander des mesures à mettre en place pour favoriser l'accès aux dons de gamètes (sperme et ovules) et d'embryons, tout en prévenant les situations préjudiciables.
Capsule 1 : Fonder une famille grâce à un don de sperme au Québec
Capsule 2 : La recherche d’un donneur de sperme en ligne
Capsule 3 : Le don de sperme en ligne
Capsule 4 : L'encadrement légal du don de sperme