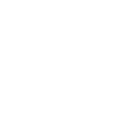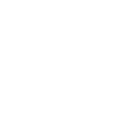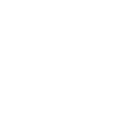Katrine Turgeon mène un important projet sur la connectivité aquatique
La professeure Katrine Turgeon (titulaire de la Chaire de recherche du Canada en socio-écologie de la conservation et de la gestion des pêches et de la faune), de l’Institut des recherche de la forêt tempérée (ISFORT-UQO) lance un nouveau projet de recherche ambitieux qui réunit quatre universités québécoises (UQO, UQAC, UQTR et McGill), le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Hydro-Québec et Conservation de la nature Canada (CNC).
Cette recherche vise à mieux comprendre les impacts de l’utilisation des terres et des changements globaux sur la connectivité écologique aquatique et la biodiversité.
Rappelons que Katrine Turgeon est titulaire depuis 2024 de la Chaire de recherche du Canada en socio-écologie de la conservation et de la gestion des pêches et de la faune.

Ce partenariat multidisciplinaire mis sur pied par la professeure Turgeon s’attaque à une problématique cruciale : la préservation des écosystèmes aquatiques et leur résilience face aux défis environnementaux. Elle souligne que ce projet répond directement aux priorités stratégiques des partenaires impliqués, notamment :
• MELCCFP : Conserver et valoriser la biodiversité, protéger les habitats essentiels des poissons et renforcer la planification écologique grâce à des données sur la connectivité aquatique.
• Hydro-Québec : Intégrer des mesures de biodiversité dans ses projets et approfondir les connaissances sur la faune aquatique pour favoriser la connectivité écologique, conformément à son Plan d’action en faveur de la biodiversité.
• Conservation de la Nature Canada : alimenter l’Initiative québécoise Corridors écologiques (IQCÉ) pour accélérer la conservation de milieux naturels connectés.

Des retombées concrètes pour la conservation et la gestion des écosystèmes aquatiques
Ce partenariat permettra de produire des cartes de connectivité aquatique validées à plusieurs échelles spatiales (régionale, bassin versant et tronçons de cours d’eau). Ces outils innovants aideront les partenaires à identifier les barrières potentielles au déplacement des espèces aquatiques, caractériser les habitats critiques et prioritaires pour la conservation, quantifier le potentiel d’adaptation des espèces face aux changements climatiques et développer des stratégies proactives de détection et de prévention des espèces exotiques envahissantes.
Les résultats guideront également l’adaptation des plans directeurs de protection de la biodiversité du MELCCFP et d’Hydro-Québec, tout en enrichissant la boîte à outils de la plateforme IQCÉ.
Il s'agit d'un projet de 5 ans et les premiers résultats sont attendus dans les deux à trois prochaines années, selon Katrine Turgeon.
Un enjeu de taille pour le Québec et le Canada
Katrine Turgeon rappelle que le Québec et le Canada dépendent fortement de leurs écosystèmes aquatiques. Le Canada possède 18 % des réserves mondiales d’eau douce et la pêche récréative génère 4,9 milliards de dollars par an. Le Québec avec ses dizaines de milliers de rivières et plus de trois millions de plans d'eau, possède 3 % des réserves d'eau douce, dont environ 40 % se trouvent dans le bassin du Saint-Laurent. Depuis 1970, la biodiversité dépendant des eaux douces a chuté de 83 % à l’échelle globale, un déclin plus marqué que pour tout autre groupe d’espèces.
« Le maintien de la connectivité aquatique est essentiel pour soutenir la biodiversité, préserver les milieux humides et garantir la résilience des écosystèmes. Ce projet s’inscrit donc dans une vision durable visant à concilier conservation de la biodiversité et usage responsable de nos ressources naturelles », explique Katrine Turgeon.
Une approche scientifique novatrice
Pour la première fois, une analyse multi-échelle combinera des données empiriques et des concepts novateurs de connectivité fonctionnelle, structurelle et terrestre-aquatique. Cette méthodologie permettra d’anticiper les effets des changements globaux sur les réseaux hydrographiques et d’adapter les mesures de gestion et de conservation.
Citations des partenaires
• « En intégrant les résultats à nos projets, nous pourrons mieux planifier nos interventions en vue de réduire notre empreinte environnementale et ainsi s’assurer d’une meilleure préservation de la biodiversité sur le territoire Québécois. » – Céline Cusson, directrice Environnement - d’Hydro-Québec
• « Les données générées viendront renforcer les efforts pour connecter les habitats et préserver la biodiversité aquatique à l’échelle régionale. » – Carine Deland – directrice de la conservation chez Conservation de la nature Canada
Le 16 octobre 2025