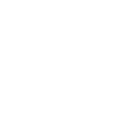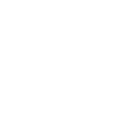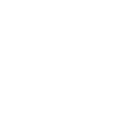Nouvelle publication de la professeure Iulia Mihalache
La professeure Iulia Mihalache, du Département des sciences sociales, vient de faire paraître un article dans la revue redit - Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación.
L’audiodescription (AD) est un service d’assistance artistique et médiatique en plein essor « qui rend les produits audiovisuels accessibles et agréables pour le public aveugle et les personnes malvoyantes en transférant des images et des sons flous dans une narration verbale qui interagit avec les dialogues et les sons du texte original avec lequel elle forme un tout cohérent » (Reviers et Vercauteren 2013 dans Vercauteren 2016 : 11). Comme objet d’étude et comme pratique intersémiotique, intersémiosphérique ou intermodale, l’audiodescription est devenue un domaine d’intérêt majeur non seulement en traduction audiovisuelle, mais aussi en traductologie (Taylor et Perego 2022). Cet intérêt va de pair avec les développements technologiques dans l’industrie de la traduction qui reflètent quelques tendances mondiales, parmi lesquelles l’augmentation du besoin de localisation (traduction) audiovisuelle (Bussey 2019 : en ligne).
Dans cet article, nous présentons et analysons notre propre performance, en tant qu’étudiante au Master Traduction Audiovisuelle : Localisation, Sous-titrage et Doublage (ISTRAD, Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, et Université de Cadix) (promotion 2020-2022), de l’audiodescription du film d’animation Pour la France, un film de fin d’études en animation 2D, à thématique historique, réalisé en 2019 par Vincent Chansard, dans le cadre de la formation « Concepteur et réalisateur de films d’animation » de Gobelins, école de l’image. Le but de ce projet pratique de fin de master a été non seulement de proposer un scénario d’audiodescription, créé dans le logiciel Aegisub et enregistré dans le logiciel Filmora, pour le film d’animation Pour la France (Gobelins, 2019), mais aussi d’appliquer nos connaissances dans le domaine de l’audiodescription, de la traduction audiovisuelle ou des technologies TAV et nous interroger sur notre propre pratique.
Après avoir défini notre cadre théorique, nous exposons notre méthodologie basée sur les principales étapes de réalisation de ce mode de traduction qu’est l’audiodescription, en mettant en relief les différents défis que nous avons rencontrés et les solutions que nous avons apportées.
Le principal défi a été de reconstituer la trame historique du film à l’aide d’images qui étaient modifiées ou stylisées pour qu’elles se prêtent bien au style d’un film d’animation. Même lorsque nous avons pu déterminer les informations contenues dans une image, il a fallu faire des choix quant aux informations à inclure dans la description et aux informations à omettre, notamment en raison des contraintes techniques. D’autres défis se sont présentés en cours de route. Par exemple, le produit audiovisuel devrait-il être abordé à la manière de n’importe quel texte source à traduire ? Quelle définition de la « traduction » ou quelle approche traductive devrions-nous appliquer lors de la description vidéo des images et des autres informations sonores qui ne peuvent pas être interprétées correctement sans les images d’accompagnement ? Quelles techniques devrions-nous utiliser pour sélectionner le contenu à audiodécrire, comment prioriser l’information et comment inclure l’information pertinente entre les dialogues et les bruitages ? De quelle manière pouvons-nous garantir que le public aveugle ou malvoyant crée les inférences et le sens de la production, de même que des représentations mentales de l’action du film, de la même manière qu’une personne qui n’a pas de déficience visuelle, tout en sachant que le public visé même n’est pas homogène et que sa relation avec le monde cinématographique n’est pas le même non plus ?