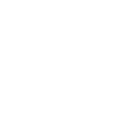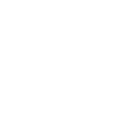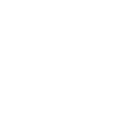Recherche et création
Christiane Guay
Protection de la jeunesse d’un point de vue autocthone
Au Canada, les jeunes autochtones sont surreprésentés dans les systèmes de protection de la jeunesse. Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, 50 % des enfants pris en charge sont Autochtones, bien qu’ils ne représentent que 7,7 % de la population d'enfants au pays. Une des raisons, c’est que ces systèmes ont été élaborés à partir d’une conception occidentale de la famille ce qui engendre des effets discriminatoires lorsqu’ils sont appliqués en contexte autochtone. Une réalité que la professeure en travail social de l’UQO, Christiane Guay, connait très bien. Elle travaille depuis une dizaine d’années à étudier et valoriser les pratiques culturelles et traditionnelles innues d’éducation, de garde coutumière, d’intervention sociale et de guérison sur le territoire. Faire reconnaitre ces pratiques et les traditions juridiques autochtones dans le domaine de la protection de l’enfance, a donné des résultats probants.
Professeur au Département de travail social de l’UQO, Christiane Guay possède un parcours qui démontre qu’on peut trouver sa voie et s’imposer dans le domaine de la recherche appliquée, même après une longue carrière professionnelle. Après vingt ans à occuper des fonctions de travailleuse sociale en milieu scolaire, de superviseure clinique et de gestionnaire des services sociaux, Christiane Guay a décidé de poursuivre des études postdoctorales à l’UQO. Maintenant professeur au Département de travail social, elle s’intéresse de près au renouvellement de la pratique du travail social en contexte autochtone et plus particulièrement à la manière dont les Premières Nations conçoivent la famille, la protection des enfants et l’intervention sociale.
Grâce notamment au financement du Conseil de recherches en sciences humaine du Canada (CRSH), les résultats des recherches de Christiane Guay ont jusqu’ici, permis de faire reconnaître dans le Code civil québécois, la garde coutumière innue. Grâce à ses travaux, la Loi sur la protection de la jeunesse a aussi été modifiée afin d’élargir la gamme de pouvoirs pouvant être exercés par les communautés autochtones en matière de protection de la jeunesse et de permettre à ces communautés de faire entendre leur voix devant le tribunal lorsque la situation d’un de leurs enfants est judiciarisée
« Une des barrières qui empêchent la reconnaissance des pratiques culturelles et des traditions juridiques des Autochtones, c’est qu’elles relèvent de la tradition orale. Il n’existe pratiquement pas d’écrits qui expliquent les traditions, les pratiques et les normes qui régissent les communautés autochtones, du moins dans le champ du travail social. En étudiant et valorisant les coutumes et traditions relatives aux modes de vie des familles, ainsi qu’au processus d’intervention et de guérison de la Nation innue, j’ai voulu entre autres, démontrer que les familles des Premières Nations ne subissent pas de façon statique les politiques oppressives et coloniales qui ont marqué et continuent de marquer leur vie. Au contraire, elles s’adaptent, résistent et font preuve de résilience en s’appuyant sur un ensemble de pratiques culturelles toujours actuelles. Il existe des solutions au sein même des communautés autochtones, des manières culturelles et traditionnelles de prendre soin et de protéger les enfants. Contrairement aux sociétés occidentales, les Autochtones ont une conception élargie de la famille. Pour les Innus par exemple, il existe des formes spécifiques de relations familiales comme la cohabitation et la garde coutumière. Si les allochtones qui interviennent auprès des Peuples autochtones connaissaient mieux ces pratiques, ils seraient mieux à même de les exploiter. Miser sur les forces des familles autochtones permettrait de partir d’elles et non de nous pour imaginer des solutions créatives aux problèmes auxquels elles sont confrontées »
Christiane Guay, Professeur en sciences sociales et appliquées, UQO
Au moment de réaliser sa thèse postdoctorale, Christiane Guay était au fait des résultats positifs d’un projet pilote de protection de l’enfance chez les Attikameks et elle avait aussi une bonne connaissance des façons de faire de la Nation Crie pour avoir travaillé avec eux pendant cinq ans. C’est une travailleuse sociale d’origine innue, Nadine Vollant, qui l’a incitée à orienter ses recherches du côté de la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam. Avec la collaboration du juriste Sébastien Grammond (maintenant juge à la Cour fédérale), un vaste programme de recherche a été mis en œuvre pour définir et mettre en place une gouvernance innue de la protection de la jeunesse. Les deux universitaires ont d’ailleurs reçu en 2017, le Prix Droits et Libertés remis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour leur contribution au développement des connaissances en matière de gouvernance autochtone de la protection de la jeunesse.
Pour la chercheure Christiane Guay, ce n’est qu’un début, car il reste beaucoup de travail à faire, notamment dans le reste du Canada et au niveau fédéral et provincial, pour faire reconnaitre le droit des peuples autochtones à légiférer et à dispenser leurs propres services de protection de la jeunesse. Pour se faire, elle collabore avec le Réseau DIALOG et le laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones Mikwatisiw et peut compter sur le soutien financier du Fonds de recherche société et culture (FRQSC) ainsi que le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) à travers, notamment ses partenariats avec le collectif LÉGITIMUS dirigé par le professeur Ghislain Otis, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones, et Accès au Droit et à la justice (ADAJ) dirigé par le professeur Pierre Noreau de l’Université de Montréal.
Pour en savoir plus :
Reportage de Radio-Canada sur la reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone
Lettre d’opinion signée, publiée dans La Presse le 7 mars 2019