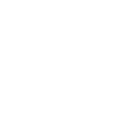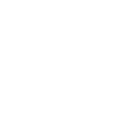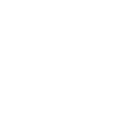Six professeur.es et 12 étudiant.es obtiennent des bourses du FRQ
Six professeur.es et 12 étudiant.es de l’Université du Québec en Outaouais obtiennent des appuis du Fonds de recherche du Québec 2022 pour divers projets.
« Tous ces projets sont révélateurs d’une certaine identité de la recherche à l’UQO. La recherche à l’UQO est résolument en dialogue avec le monde professionnel, et cette caractéristique, nous la retrouvons tant en sciences de l’éducation, en muséologie, en travail social, en génie, ou encore en psychologie, affirme Jonathan Paquette, doyen de la recherche à l’UQO. Ces projets mettent en relief la capacité de l’UQO à se positionner dans des domaines novateurs et stratégiques pour la recherche sur notre société. »
Regroupés sous l’appellation « Fonds de recherche du Québec », les trois Fonds – Nature et technologies, Santé, Société et culture – ont pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la mobilisation des connaissances et la formation des chercheurs au Québec et d’établir les partenariats nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, a récemment annoncé les résultats 2022-2023. Les FRQ investissent 71,2 millions $ en bourses et 190,4 millions $ en subventions cette année pour un total global de 261,6 millions $.

Professeures et professeurs (par ordre alphabétique):
Mélanie Boucher, professeure à l’École multidisciplinaire de l’image
Créer avec les collections : des usages muséaux en recherche-création. 258 813 $ sur quatre ans dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche.
La Nouvelle équipe Art et musée : entre recherche et création est sous la direction scientifique de la chercheuse Mélanie Boucher. Leur premier projet, Créer avec les collections : des usages muséaux en recherche-création, réunit pour la première fois au Québec des artistes, des designers graphiques, des pédagogues et des commissaires de l’UQO, de l’UQAM et de l’Université Laval. Le projet qui se déploiera au cours des quatre prochaines années porte sur l’emploi des collections muséales en recherche-création, à partir d’une approche interdisciplinaire et intersectorielle favorisant le développement d’initiatives collaboratives en muséologie, en arts, en histoire de l’art, en design graphique et en éducation rattachées au champ de la performance, des expositions et de l’édition. Les œuvres, les projets curatoriaux et de médiation ainsi que les productions expographiques et en design graphique qui interrogent les emplois classiques et normés des collections muséales et s’en démarquent sont considérés. La Galerie UQO ainsi que des spécialistes en numérique de l’UQO et de l’UdeM qui sont affiliés au laboratoire de muséologie numérique l’Ouvroir de l’UdeM agissent aussi à titre de collaborateurs.
« Les musées sont des producteurs de savoirs. Mais ils offrent également des possibilités de création qui gagnent à être reconnues. Je suis particulièrement stimulée à l’idée de piloter cette équipe de spécialistes, dans un cadre qui contribuera à cette reconnaissance de la recherche-création dans les collections et les musées d’art », explique Mélanie Boucher .
Halim Boutayeb, professeur au Département d'informatique et d'ingénierie
Recherche et développement de nouveaux systèmes de récupération de l’énergie électromagnétique en utilisant des antennes et des métasurfaces innovantes
114 300 $ sur trois ans.
Voici le résumé de son projet de recherche: Les systèmes de télécommunications modernes, l'avènement de l'Internet des objets et l’utilisation de nouveaux capteurs et de nouveaux dispositifs électroniques pour les applications biomédicales nécessitent une énergie interne ou externe permanente pour assurer leurs longévités.
De plus, le transfert sans fil de puissance à longue distance a récemment été considéré comme un moyen révolutionnaire de transférer la puissance à partir de satellites qui collecteraient l’énergie solaire avec une grande efficacité, la convertiraient en puissance micro-ondes, puis enverraient cette puissance micro-ondes à l’aide d’antennes directives vers des endroits spécifiques sur Terre.
L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier et de développer de nouveaux systèmes de récupération de l’énergie électromagnétique en utilisant des antennes émergentes et de nouvelles métasurfaces. Nous développerons en parallèle des systèmes destinées aux objets connectés et aux capteurs ainsi que des systèmes qui pourront être utilisés pour la transmission sans fil de puissance.
Pour mener à bien ce projet de recherche, des techniques d’analyse seront développées en utilisant des méthodes numériques tels que la méthode des différences finies dans le domaine temporel et la théorie des modes caractéristiques. Ces études seront validées par des fabrications de prototypes et des mesures expérimentales tout au long du projet.
Alice Friser, professeure au Département des sciences administratives
Éviter la controverse : stratégies et conditions de succès.
57 150 $ sur trois ans.
Isabelle Marchand, professeure au Département de travail social
Mieux soutenir pour bien vieillir dans les Laurentides.
694 554 $ sur trois ans.
« Mieux comprendre les besoins des personnes aînées, notamment celles du grand âge, et développer des stratégies innovantes de soutien au vieillir chez soi, particulièrement dans les municipalités rurales, apparaît crucial dans le contexte de vieillissement accéléré que connaît le Québec et ses régions » explique la professeure Marchand.
« Rappelons que faciliter le vieillir chez soi et dans sa communauté s’inscrit dans les priorités du gouvernement québécois quelque 20 ans. Toutefois, les demandes de services de soutien à domicile augmentent chaque année, et les services de santé, qui peinent déjà à répondre aux nombreux besoins, sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre grandissantes », précise-t-elle.
Son projet de recherche se résume ainsi : À partir d’un portrait identifiant les besoins des personnes ainées ainsi qu’un état des lieux en matière de services régionaux et locaux, le laboratoire vivant vise à élaborer et expérimenter des stratégies innovantes permettant le bien vieillir chez soi et dans sa communauté, en tenant compte des réalités socioterritoriales des Laurentides. En étroite collaboration avec le Centre intégré de la santé et des services sociaux des Laurentides, et bénéficiant de l’appui d’une douzaine d’organisations partenaires, dont le Conseil des préfets des Laurentides, Centraide Laurentides et Haute-Laurentides, la FADOQ Laurentides et Table de concertation régionale des ainés des Laurentides, la professeure Marchand et ses collaborateurs développeront cette expérimentation dans les MRC d’Argenteuil et d’Antoine-Labelle, avec l’appui des MRC respectives ainsi que des organismes locaux offrant des services aux personnes ainées. Les résultats de ce premier laboratoire vivant dans les Laurentides permettront d’alimenter des initiatives dans les autres MRC des Laurentides ainsi que d’autres régions au Québec.
Geneviève Pagé, professeure au Département de travail social
Le placement et l’adoption en protection de la jeunesse au Québec : regards écosystémiques sur les trajectoires de vie des enfants, leurs réseaux familiaux, le système sociojudiciaire et les pratiques.
621 545 $ sur quatre ans dans le cadre du programme Soutien aux équipes de recherche.
L’Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse (ERPAPJ), dirigée par la professeure Geneviève Pagé, du département de travail social, a obtenu le renouvellement de sa subvention du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) pour 4 ans. Cette équipe regroupe 13 chercheuses et chercheur universitaires, 6 cochercheuses des milieux de pratiques, 4 collaboratrices et 11 organismes partenaires. Depuis sa création en 2014, l’ERPAPJ est la seule équipe de recherche au Québec à proposer une programmation complète dédiée à l’avancement des connaissances et des pratiques en lien avec le placement et l’adoption des enfants en contexte de protection de la jeunesse.
« Je suis extrêmement fière du renouvellement de la subvention de notre équipe, affirme la professeure Pagé. Dans la foulée des recommandations de la Commission Laurent, de la réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la réforme du droit de la famille, cette subvention va nous permettre de poursuivre nos travaux de recherche en concertation avec nos organismes partenaires pour soutenir l’amélioration des pratiques et des politiques, pour le mieux-être des enfants placés ou adoptés et leurs familles. »
Jérémie Verner-Filion, professeur au Département des sciences de l’éducation
L’impact de la passion pour une activité parascolaire sur le bien-être psychologique, la persévérance et la réussite scolaires des adolescents.
56 869 $ sur trois ans dans le cadre du programme Soutien à la recherche pour la relève pastorale.
« Je suis évidemment bien fier d’avoir obtenu cette subvention qui servira de tremplin pour lancer mes projets de recherche en tant que professeur de la relève à l’UQO!», affirme le professeur Verner-Filion.
En résumé, le projet consiste à investiguer les effets des activités parascolaires sur le fonctionnement optimal des adolescents en contexte scolaire. Bien que les résultats de recherche antérieures démontrent généralement que la pratique d’activités parascolaires soit associée à des bénéfices pour les adolescents, certaines études soutiennent qu’un surinvestissement dans ce type d’activité puisse avoir des conséquences néfastes sur leur parcours scolaire. La documentation scientifique sur le sujet a toutefois tendance à étudier les effets des activités parascolaires de manière dichotomique en comparant les élèves pratiquant de telles activités à ceux qui n’en pratiquent pas. Rares sont les études qui tiennent compte des motivations qui sous-tendent l’engagement des adolescents dans ce type d’activités pour en comprendre les conséquences. De plus, les activités parascolaires font partie de l’identité des adolescents qui les pratiquent. Ainsi, il est fréquent pour ces derniers de se définir (au moins en partie) par l’entremise de ces activités qui représentent pour eux de véritables passions. D’un point de vue théorique, la passion représente à la fois un processus motivationnel et identitaire qui est associé à de multiples conséquences, autant au sein de la pratique de l’activité qu’à l’extérieur (p.ex.: à l’école). Conséquemment, mon programme de recherche vise à mieux comprendre l’influence de la passion pour une activité parascolaire sur la qualité des conséquences scolaires (motivation académique, persévérance, bien-être psychologique et réussite scolaires) vécues par les élèves du secondaire. Ce projet aura comme retombée de mieux comprendre l’influence des motifs qui sous-tendent l’implication dans des activités parascolaires pour ainsi mieux saisir les paramètres permettant de déterminer la qualité des conséquences scolaires vécues par les élèves qui les pratiquent.
Étudiantes et étudiants (par ordre alphabétique) :
Pierre-Louis Audette, Bourse de maîtrise en recherche
L’efficacité de l’intégration perceptive d’un visage prédit-elle les différences individuelles en reconnaissance de visages et d’objets?
35 000 $
Valentina Buttò, Bourse de recherche doctorale
Évaluation pancanadienne de la résilience des communautés forestières par l’étude des traits fonctionnels
90 000 $
Marie-Claude Desjardins, Bourse de maîtrise en recherche
L’impact des facteurs culturels sur le développement des processus cérébraux et perceptifs fondamentaux liés au décodage de l’expression faciale de douleur.
35 000 $
Raphaëlle Fréchon, Bourse de doctorat en recherche
Repenser la conservation dans une ère de changements globaux : analyses des retombées et tendances écologiques, socio-économiques et institutionnelles des aires protégées au Québec.
84 000 $
Noémie Landry, Bourse de maîtrise en recherche
Stimulation thêta-burst et connectivité cérébrale entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex cingulaire antérieur subgénual : une étude combinant la stimulation magnétique transcrânienne à l’électroencéphalographie.
23 334 $
Audrey-Anne Laurin, Bourse de doctorat en recherche
Rôle du coyote sur la dynamique spatiale du cerf de Virginie : évidence indirecte de cascades trophiques comportementales en forêt tempérée
70 000 $
Andréanne Lebrun, Bourse postdoctorale
Les étudiant.e.s en enseignement au primaire et au secondaire et le passé scolaire québécois : enjeux pour la valorisation de la profession enseignante et la formation des maîtres
90 000 $
Vicki Ledrou-Paquet, Bourse de maîtrise en recherche
L’impact de l’ethnie sur l’extraction de l’information visuelle mesuré à l’aide d’un paradigme d’adaptation en électrophysiologie
35 000 $
Rose Poirier, Bourse de maîtrise en recherche
Image corporelle positive selon l’identité de genre chez les personnes de 18 à 30 ans
35 000 $
Christian Pépin, Bourse postdoctorale
Les secteurs « verts » : transition juste ou relations de travail inégalitaires? Une analyse comparée des cas québécois, canadien et états-unien
90 000 $
Geneviève Thibault, Bourse de maîtrise en recherche
Explorer l’altérité par la pratique photographique dans l’observation matérielle et sensible de l’espace habité
17 500 $
Karine Villeneuve, Bourse de maîtrise en recherche
Transformer le rapport à l’écrit des élèves en classe de français au secondaire : conception et mise à l’essai d’ateliers d’écriture créative.
35 000 $
Félicitations aux récipiendaires de subventions du FRQ 2022!
Le 20 juin 2022