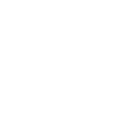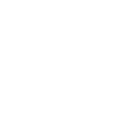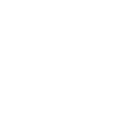Audrey Rousseau, récipiendaire de la subvention relève professorale du FRQSC
Félicitations à la professeure Audrey Rousseau, récipiendaire d'une subvention octroyée par le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC).
Dans le cadre du programme Soutien à la recherche pour la relève professorale du FRQSC, la professeure Rousseau a reçu une subvention de 45, 000$ pour son projet de recherche qui sera financé sur 3 ans. Le sujet portera sur « Penser la continuité des expériences : défier les logiques différentielles à l’oeuvre dans les discours de justice et de réparation au sujet des Buanderies Madeleine et des Foyers pour mères et enfants en République d’Irlande (1993-2021) ».
RÉSUMÉ
Le dévoilement, dans les années 90, des conditions de vie et de détention des femmes et de filles enfermées et forcées au travail dans les Buanderies Madeleine (18e-20e siècles) a créé une onde de choc auprès du public irlandais, qui a dû apprendre à intégrer la mémoire d’un passé difficile. Plus récemment, l’identification d’une fosse commune de près de 800 enfants à Tuam a relancé le dialogue social sur les abus perpétrés au sein des Foyers pour mères et enfants (20e siècle), Ainsi, depuis quelques décennies, l’attention accordée aux violences institutionnelles faites aux mères célibataires et à leurs descendances continue d’alimenter une riche littérature scientifique en Irlande (Earner-Byrne, 2007; Buckley et McGregor, 2019) et suscite des actions organisées par les survivantes et leurs alliées afin d’assurer un « devoir de mémoire » (Ricoeur, 2000). Que ce soit dans le travail des commissions d’enquête (Ryan en 2009, McAleese en 2013, ou la CIMBH dont le rapport est dû en 2020), dans les médias ou dans la recherche universitaire, on observe une tendance à étudier en vase clos ces institutions dirigées par les religieuses. Pourtant, de nombreux témoignages d’histoire orale (Magdalene Institutions) font état de transferts interinstitutionnels, notamment entre les Buanderies Madeleine et les Foyers pour mères et enfants, forçant à questionner : pourquoi les remémorations d’ injustices historiques se passent-elles en vase clos (Buanderies vs Foyers)? En quoi ce traitement différencié interfère-t-il dans les discours de justice et de réparation au sujet des Buanderies et des Foyers (1993-2021)?
Notre hypothèse est que contrairement aux élus ou aux journalistes, c’est parmi les survivantes (et leurs descendants) que les critères de distinction (entre les Buanderies et les Foyers) seront les plus faibles. Si cette observation est confirmée, cela appuiera l’idée voulant que la logique différentielle opère une rupture (cassure) avec la continuité de l’expérience vécue et participe à invisibiliser certaines trajectoires de vie. Afin de repérer ces critères de distinctions et leur effet (conséquence) sur les discours, notre étude empruntera une approche de type compréhensive, qui greffe l’herméneutique ricoeurienne sur l’analyse de textes assistée par ordinateur. Cela implique d’ étudier les interprétations des survivantes et de leurs descendants (histoire orale), puis de les croiser avec d’autres textes (de presse écrite et parlementaire) et des entretiens semi-dirigés qui permettront de constituer l’horizon de dialogue entre ces mémoires individuelles et collectives.
Les objectifs de cette recherche sont :
1) d’améliorer la compréhension de l’histoire sociale entourant la répression des femmes en Irlande au 20e siècle,
2) de valoriser des perspectives d’enquête respectueuse de l’agencéité (capacité de dire et de faire) des personnes directement affectées par ces violences. Défier la tendance, à la fois sur la scène politique et universitaire, à analyser ces institutions (les Buanderies et les Foyers) de manière séparée, permettra, c’est du moins notre proposition, de penser la continuité de l’expérience vécue en luttant contre les risques de déqualification de la parole des témoins de l’histoire.