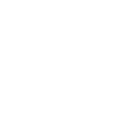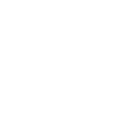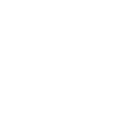Colloque étudiant PARCOURS : INVESTIR LES ARTS ET LES MUSÉES
Colloque étudiant de la maitrise en muséologie et pratiques des arts
2 Avril 2019 de 9h30 à 16h30
Auditorium A-0200
Université du Québec en Outaouais (pavillon Lucien-Brault)
Les étudiant.e.s du Forum 2018-2019 de la maîtrise en muséologie et pratiques des arts de l’École multidisciplinaire de l’image (Émi) vous présentent l’avancement de leurs recherches. L’évènement a pour objectif de promouvoir et de partager la recherche aux cycles supérieurs en muséologie et pratiques des arts, au moment où les étudiant.e.s se préparent à s’engager dans la dernière étape de leur parcours. Celui qui consiste à se concentrer pleinement à l’écriture et à la création de leur projet.
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons un moment convivial d’échanges et de discussions autour des grands thèmes du design graphique, des expositions, des collections, de la bande dessinée, des publics ainsi que des théories de l’art. Une réflexion sur la méthode de recherche empirique sera également proposée par la conférencière invitée, Bénédicte Ramade.
Programme
9h30 – Accueil
9h35 – Mot de bienvenue
Mélanie Boucher, professeure, MMA6023 Forum de maîtrise 2018-2019
Première partie : Exposition. Présentation et représentation
9h45 – Utiliser la BD sans l’exposer : le cas du MCG
Alice Wickert
10h15 – La Déportation des Acadiens : signification, pertinence et perceptions
Samuel Landry
10h45 – Exposer le corps photographique : ambiguïté entre l’inerte et le vivant
Jessica Ragazzini
11h15 – Pause
Conférencière invitée
12h00 – Questions de méthode
Bénédicte Ramade
13h00 – Dîner
Deuxième partie : L’art de l’approche transdisciplinaire
14h00 – Faire un pas de côté : délimiter et définir les balises d’une recherche-création en mouvement
Daniel Leblanc
14h30 – La représentation visuelle des données
Pierre Dion-Bisson
15h00 – Pause
Troisième partie: Muséalisation, art et enjeux numériques
15h15 – Musée et culture numérique
Joséphine Bruguet
15h45 – L’analyse des pratiques
Judith Falardeau
16h15 – Clôture
Présentation de la conférencière invitée
Questions de méthode
Comment se plonger dans le champ de la recherche universitaire sans toutefois s’isoler ? Afin de contourner cet écueil, l’approche empirique a toujours constitué le parangon des multiples activités professionnelles et académiques développées par Bénédicte Ramade. Critique d’art et commissariat, ces deux pratiques de l’expérience des œuvres et des expositions sédimentent son analyse théorique, prenant à revers les méthodologies traditionnelles qui visent à choisir des pensées et des théories puis à les défendre à coups de corpus. En privilégiant l’approche concrète, c’est la fabrique de l’art, de sa mise en exposition et de son institutionnalisation qui est analysée, non en silos, mais sur un principe de synergie. Une méthode qui peut se permettre alors d’analyser la méconnaissance d’un mouvement comme celui de l’art écologique américain auquel elle a consacré son doctorat et de donner une nouvelle amplitude à cette première expertise scientifique sur les questions environnementales dans l’art grâce au travail de terrain. À partir de l’exposition The Edge of the Earth à Toronto, c’est le concept de l’Anthropocène et ses enjeux pour la discipline de l’histoire de l’art qu’elle fouille, cherchant à inscrire sa discipline de référence dans le champ des humanités environnementales.
Bénédicte Ramade est historienne de l’art, spécialisée dans l’art écologique auquel elle a consacré son doctorat (L’art écologique américain, proposition d’une réhabilitation critique, Paris 1, Panthéon Sorbonne, 2013). Ses recherches les plus récentes consacrées à l’Anthropocène l’ont amenée à étudier le déploiement des humanités environnementales dans le champ de l’histoire de l’art et la portée des études animales dans la révision du primat anthropocentrique. Elle a récemment dirigé le dossier « Point de vue animal/Animal Point of View » de la revue Espace art actuel. Commissaire de plusieurs expositions sur les questions environnementales (Acclimatation, Villa Arson, 2009-2010, Rehab, L’art de re-faire, Fondation EDF, Paris, 2010-2011, The Edge of the Earth, Climate Change in Photography and Video , Ryerson Image Center, Toronto, 2016), elle vient de collaborer à l'exposition de Karine Payette, Espaces sans espèces, à la Salle Alfred-Pellan, Maison des arts de Laval. Bénédicte Ramade est chargée de cours à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Montréal, critique d’art et commissaire indépendante
Présentations des conférenciers.ères étudiant.e.s
Alice Wickert
Sujet : La bande dessinée au musée: exposante et exposée
Axes de recherche principaux : Bande dessinée, codes, récit en images, objet, expographie, scénographie, exposition, histoire
Ayant pour sujet la bande dessinée au musée, son mémoire explore et analyse la place de la BD dans les institutions muséales, et ce non seulement en tant qu’objet, mais aussi en tant que principe expographique. Elle aborde de manière générale les expositions utilisant les codes de la BD et celles ayant la BD comme sujet en déterminant les possibilités et les défis de mise en exposition du médium selon les standards muséaux des dix dernières années.
La conférence Utiliser la BD sans l’exposer : le cas du MCG présente une étude de cas de l’exposition Un ciel meurtrier présentée au Musée canadien de la guerre en 2016.
Samuel Landry
Sujet : La représentation de la Déportation des Acadiens dans le musée : comparaison entre le Musée canadien de l’histoire et le Musée acadien de l’Université de Moncton
Axes de recherche principaux : Représentation, exposition, musée, histoire, Déportation, Grand dérangement
Son essai a pour but de comparer la représentation de l’histoire et de la culture acadiennes au Musée canadien de l’histoire et au Musée acadien de l’Université de Moncton, à travers la représentation de la Déportation des Acadiens dans leurs expositions permanentes. Ce projet considère les différences et les similitudes dans l’approche des deux institutions, à partir des principales caractéristiques des expositions que sont les objets, les textes et la mise en exposition.
Cette communication intitulée La Déportation des Acadiens : signification, pertinence et perceptions cherche à résumer la signification culturelle et la place de cet évènement historique dans les musées aujourd’hui.
Jessica Ragazzini (étudiante libre)
Sujet : Existe-t-il une photographie post-humaniste ? Des frontières photographiques du corps entre le modèle vivant et le mannequin objet.
Axes de recherche principaux : Photographie, réification, animation, simulacres, corps, post-humanisme, tableau vivant, mode, arts visuels, histoire.
Sa thèse a pour sujet la confusion du corps avec l’objet dans la photographie de mode et d’art contemporain de 1960 à nos jours. D’abord, dans le langage à travers l’emploi du mot « mannequin », qui désigne à la fois l’objet anthropomorphe et une personne élégante; ensuite, affirmée dans les arts et la mode, comme en littérature, au cinéma et à travers les avancées technologiques. Ces dernières proposent une nouvelle conception de la représentation du corps vivant et de l’objet anthropomorphe inerte.
La conférence Exposer le corps photographique : ambiguïté entre l’inerte et le vivant porte sur les traitements photographiques du corps appréhendé comme nature morte et non comme sujet.
Daniel Leblanc
Sujet : Regard sur le processus de création en design graphique à partir de la variable du déplacement.
Axes de recherche principaux : Design graphique, processus de création, déplacement, hybridation, cartographie.
Sans point d’origine ou de fin, le design graphique traverse inlassablement l’espace à la recherche de nouveaux contextes à occuper. Appelant au mouvement, celui-ci ouvre un champ des possibles pour le graphiste. Cette recherche-création s’efforce ainsi de démontrer la pertinence et l’incidence de la notion de déplacement sur la manière de penser et de faire du graphiste. Pour y arriver, cette dernière tente de donner forme au processus de création où le geste de cartographier devient une manière de fonder son monde.
La communication intitulée Faire un pas de côté : délimiter et définir les balises d’une recherche-création en mouvement propose de définir et de mettre en relation les concepts-clés de ma recherche.
Pierre Dion-Bisson
Sujet : De quelles façons des variations graphiques d un diagramme affectent-elles le sens des données ?
Axes de recherche principaux : Diagrammes, variations graphiques, design d’information, base de données, big data.
Les diagrammes sont des outils extrêmement pratiques et leur utilité est réputée dans plusieurs domaines : bourse, recherche, sport, journaux, météo, etc. Il est important de prendre connaissance du pouvoir communicationnel de ceux-ci et d’être vigilant lors de la création et l’utilisation de cet outil, car même si les données proviennent d’une même source, les diagrammes peuvent en infléchir le sens.
La conférence La représentation visuelle des données se penche sur les variations graphiques au sein des diagrammes et sur l’impact qu’elles ont sur le sens des données.
Joséphine Bruguet
Sujet : L’appropriation des œuvres d’art par le public le cas du doppelganger
Axes de recherche principaux : Sosie, doppelgänger, photographie, selfie, public, appropriation, œuvre d’art, culture numérique, interaction, smartphone.
Son mémoire traite d’un récent phénomène muséal très présent sur les réseaux sociaux. Cette manifestation dépend du comportement du visiteur qui va s’approprier des œuvres d’art dans le but d’y trouver son sosie (ou doppelgänger), de se prendre en photo avec lui, puis de verser la photo sur Internet. Le mémoire analyse ces photographies et en étudie les origines, les principaux développements, les nouvelles interactions qui en découlent et les retombées pour les institutions et les visiteurs.
Cette communication intitulée Musée et culture numérique revient sur les origines du numérique et, plus particulièrement, sur ses débuts au sein des institutions muséales.
Judith Falardeau
Sujet : Les enjeux du processus de numérisation. Les collections et les professions sont-elles à risques ?
Axes de recherche principaux : la numérisation, les collections, le patrimoine, les risques, les politiques, les budgets, les professions.
Son mémoire a pour sujet les enjeux émanant du processus de numération. Depuis les 20 dernières années, les rendements politiques et les sommes obtenues pour les projets de numérisation occupent le premier rang, ainsi certaines professions perdent leurs valeurs intrinsèques et les collections subissent des risques à long terme. La recherche propose de suivre deux cas, celui de Bibliothèque et Archives Canada et celui du Musée canadien de l’histoire.
La conférence L’analyse des pratiques compare les budgets, les techniques, les professions et les collections par une approche quantitative.