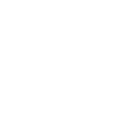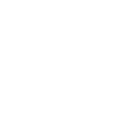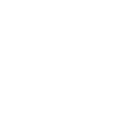Les défis à venir pour les universités francophones
Pendant trois jours, du 10 au 12 mai 2017, j’ai fait partie des 500 membres de l'Agence universitaire francophone (AUF), présidents de leur université, recteurs et autres représentants, qui se sont réunis à Marrakech, au Maroc, dans le cadre de l’assemblée générale de l’AUF afin de discuter des principales préoccupations de l’heure dans le monde universitaire à l’échelle internationale.
Le nouveau plan stratégique de l’AUF est construit autour de deux idées fortes : la solidarité active entre universités et l’ouverture au monde. Les universités membres partagent une langue, une culture et des valeurs communes.
Sans être menacés, il faut reconnaître la force de l’anglais, langue attractive qui s’impose en science et dans la culture avec comme corollaire l’affaiblissement de la pratique du français chez les jeunes. D’autres enjeux, et des plus importants, ont également été notifié, tels que le chômage des jeunes parmi les diplômés universitaires, la discrimination à l’égard des femmes, la contribution du numérique en enseignement et le virage que les universités assument à l’égard de l’entrepreneuriat. Les universités francophones doivent montrer davantage d’agilité, s’ouvrir à la maîtrise des langues, se concentrer sur plusieurs formes d’apprentissages, y compris les compétences transversales des diplômés, de même qu’à l’acquisition d’une conscience sociale. Définitivement tourné vers l’avenir à long terme, le défi consiste à s’adapter à la société de 2030. Il faut reconnaître que le français comme langue internationale est encore très vivant, et la vitalité de l’Afrique francophone en est un exemple probant.
Devant les nouvelles exigences de la compétitivité (relayée par les accréditations et les classements internationaux des universités), les réponses sont multiples et elles demandent un travail exigeant. Le chantier le plus important consiste à voir à l’amélioration de la qualité de la formation et de la recherche, afin de réduire les disparités entre les universités membres de l’AUF. Cela passe par une organisation pédagogique adaptée et un engagement ferme envers le numérique et l’assurance qualité. En effet, la qualité de la formation est la condition préalable à l’employabilité et à l’insertion des jeunes. Cet enjeu important est relayé par un second qui nécessite l’implication de l’université dans son milieu local et national. Dans ce cas, il s’agit de réduire la distance entre les universités et les écosystèmes locaux, en étant en dialogue et en partenariat avec nos environnements économiques et sociaux afin de faire de l’université un agent du développement global et local.

Le recteur de l'UQO, monsieur Denis Harrisson, à droite, en compagnie de monsieur Daniel MacMahon, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières.
L’AUF se dote de moyens avec une organisation centrale et régionale et des outils numériques à la disposition des membres. On se doit toutefois d’assurer les partenariats plus étroits entre les universités membres qui ont en commun la langue française. Bien sûr, devant tant de défis, les résultats sont incertains. Toutefois, l’université joue pleinement son rôle lorsqu’elle conserve sa pleine autonomie sans craindre de prendre des risques, tout en poursuivant le dialogue avec la société. Pour cela, il faudra rester ouvert au monde et être en mesure d’innover.
L’UQO, membre de l’AUF depuis plusieurs années, ne peut que souscrire à ces défis dont nous avons déjà entrepris la mise en œuvre à travers notre plan stratégique 2016-2020, dont plusieurs projets recoupent les priorités annoncées par l’AUF. Nos liens forts avec des partenaires universitaires internationaux ne peuvent que renforcer nos convictions et nos engagements envers nos étudiants et nos étudiantes.
Cette importante assemblée de l’AUF était précédée, le 9 mai 2017, de la rencontre du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie sous la présidence du professeur Jean-François Simard, titulaire d’une Chaire Senghor à l’UQO. Le réseau des chaires entreprend une nouvelle phase de sa jeune histoire en voulant intensifier son influence dans le monde francophone et non francophone par un élargissement du réseau, par l’adoption d’un nouveau mode d’évaluation des chaires et par le remplacement de certains titulaires. Les chaires Senghor cherchent à accroitre la production scientifique et offrir des formations spécialisées dans les universités où elles ont des assises solides. Le financement des chaires est la pierre angulaire. Il faudra que le réseau attire l’attention des décideurs publics par le déploiement d’un programme scientifique attractif. Le réseau international repose sur un solide groupe de chercheurs de différentes disciplines qui ont en commun le désir d’élargir la place du français dans le monde.