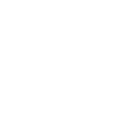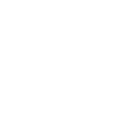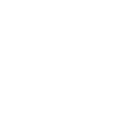CENTRE DE SOUTIEN ET D'INNOVATION EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
APPROCHES PÉDAGOGIQUES
Le savoir autochtone est divers et difficile à définir. Plusieurs caractéristiques lui sont données, incluant local, holistique, oral, personnel et expérientiel (Ingold, 2002; Hart, 2010). Selon le chef William Commanda de la nation anishinabe, les Paléo-Indiens ont « étudié les éléments géographiques et cosmologiques du monde naturel » (Thumbadoo, 2017, p. 60) accumulant ainsi au travers des générations un « savoir géo-cosmique ».
Madden (2015) identifie quatre chemins pédagogiques suivis dans l’éducation postsecondaire des personnes enseignantes. Elle propose alors une description, des objectifs et des exemples pour chacun.
1. Apprendre par les modèles traditionnels d’enseignement :
Description : Apprentissage fondé sur les savoirs traditionnels, la tradition orale, les relations avec le territoire et les protocoles locaux
Objectif : Se défaire de l’impérialisme cognitif et des structures coloniales
Exemples : Inclure les enseignements informels (comme ceux provenant du clan); Inclure la spiritualité; Inclure l’enseignement par les Ainés, les Gardiens du savoir, les artistes, etc.
2. Pédagogie pour décoloniser :
Description : Pédagogie accentuée sur l’espace conflictuel occupé par la personne apprenante en tant que personne autochtone ou allochtone dans un système colonial
Objectif : Déconstruire et reconstruire les structures d’apprentissage et les relations
Exemple : Confronter les personnes étudiantes aux histoires et expériences des personnes survivantes des pensionnats
3. Éducation autochtone et antiraciste :
Description : Éducation positionnant la personne autochtone comme étant racisée
Objectif : Déconstruire les perceptions racistes et déconstruire les rapports de force
Exemple : Appliquer des pratiques subversives comme la discrimination positive, l’intégration des personnes non blanches et l’autoanalyse des privilèges et obstacles
4. Éducation autochtone par le lieu :
Description : Éducation, souvent hors classe, qui engage les personnes apprenantes avec le lieu
Objectif : Lier les savoirs autochtones et la réconciliation au lieu
Exemple : Excursion en forêt
Quelques approches anishinabeg
Les pédagogies autochtones sont aussi variées que leurs cultures. Comme l’UQO tient ses activités principalement en territoire anishinabe, voici deux approches issues de ce Premier Peuple.
La première approche, présentée par Nicole Bell, de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, propose l’apprentissage traditionnel à l’aide de la Roue de Médecine (Bell, 2014). L’objectif de cette éducation est la sagesse (p. 6) et la bonne vie (Bell, 2013). Cette bonne vie, ou Bimaadiziwin, est la vision du monde anishinaabe qui regroupe les valeurs d’amour, d'honnêteté, de respect, de vérité, de courage, de sagesse et d’humilité (Bell, 2013, p. 94-95). Cette pédagogie nécessite la mise en relation « avec l’ensemble de l’être », soit les aspects spirituels, cognitifs, physiques et émotionnels (Bell, 2014, p. 4). C’est aussi une pédagogie cyclique, car l’apprentissage, qui est continu, suit les étapes de l’expérimentation/observation, la réplication, l’application et l’enseignement.
La seconde approche, présentée par Lawrence Gross (2010), professeur anishinaabe, a déterminé dix-neuf éléments de la pédagogie anishinaabe qu’il applique dans son enseignement. Selon ce professeur, « développer un être humain anishinaabe complètement capable de fonctionner dans la société et le monde du peuple » (p. 23) est la finalité de l’éducation. Ces éléments sont :
- le sens de la famille;
- le sens de la communauté;
- le sens du lieu;
- la tradition orale;
- la narration des récits;
- les relations, l’équilibre;
- l’union du passé, du présent et du futur;
- l’ouverture au mystère;
- l’observation;
- la vision;
- l’identité de soi positive;
- le pardon;
- le pragmatisme;
- la maitrise;
- la pensée par accumulation;
- la reconnaissance de la complexité de la nature de la vérité;
- le respect pour les personnes des autres cultures;
- l’humour.
Qu'est-ce que la décolonisation?
La décolonisation est un concept dont la définition et la mise en oeuvre varient selon chaque individu et communauté.
Selon Maldonado-Torres (2007), le colonialisme « désigne une relation politique et économique dans laquelle la souveraineté d’une nation ou d’un peuple est détenue par une autre nation » (p. 243).
Du moment spécifique de la conquête des Amériques par les Européens blancs (Maldonado-Torres, 2007) émerge la codification des relations raciales et le rattachement du travail autour du capital et du marché mondial (Quijano, 2000). Toujours selon Maldonado-Torres (2007), la colonialité est l’intégration de ces deux éléments dans la société.
Cette société devient donc moderne, puisque les « relations matérielles, subjectives et intersubjectives ont été produites aux côtés de l’émergence d’une nouvelle structure de pouvoir eurocentrée, capitaliste et coloniale mondiale » (Quijano, p. 220-221). L’UQO, en cela, peut être définie comme une université moderne. Or, pour de Oliveira Andreotti et al. (2015), la décolonisation est directement en rapport avec la modernité et ses violences. Ceux-ci ont identifié des espaces d’articulation de la modernité et de la décolonisation dans lesquels les universités et les universitaires peuvent se trouver. Ces espaces se distinguent par leurs « différents engagements, analyses et orientations » (p. 25). Ces espaces vont de l’affirmation des valeurs de la modernité à son rejet total.
Au final, pour Tuck et Yang (2012), la décolonisation de l’école, des méthodologies, et donc, de l’université, n’est qu’une métaphore, puisque ces discours ne reconnaissent pas réellement les peuples autochtones, leurs luttes, leur souveraineté et leurs contributions (p. 2-3) et serait en ce sens vide de sens (p. 7). Au contraire, la réelle décolonisation requiert le rapatriement de la vie et du territoire autochtone (p. 21).
Références
- Bell, N. (2013). Anishinaabe Bimaadiziwin : Living Spiritually with Respect, Relationship, Reciprocity, and Responsibility. Dans A. Kulnieks, R. Longboat et K. Young (Dir.) Contemporary Studies in Environmental and Indigenous Pedagogies: A Curricula of Stories and Place, 89-108. Sense Publishers. EBSCOhost.
- Bell, N. (2014). Teaching by the Medicine Wheel: An Anishinaabe framework for Indigenous education. Education Canada, 54(3).
- Gross, L. W. (2010). Some Elements of American Indian Pedagogy from an Anishinaabe Perspective. American Indian Culture and Research Journal, 34(2), 11-26.
- Hart, M. A. (2010). Indigenous Worldviews, Knowledge, and Research: The Development of an Indigenous Research Paradigm. Journal of Indigenous Voices in Social Work, 1(1), 1-16.
- Ingold, T. (2002). The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge. ProQuest.
- Madden, B. (2015). Pedagogical pathways for Indigenous education with/in teacher education. Teaching and Teacher Education, 51, 1-15. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.05.005
- Maldonado-Torres, N. (2007). On the coloniality of being: Contributions to the development of a concept. Cultural Studies, 21(2-3), 240-270.
- Quijano, A. (2000). Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America. International Sociology, 15(2), 215-232.
- Tuck, E., et Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 1(1), 1-40.
- Thumbadoo, R. V. (2018). Ginawaydaganuc and the Circle of All Nations. The Remarkable Environmental Legacy of Elder William Commanda. [thèse de doctorat, Université Carleton].