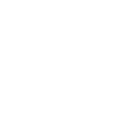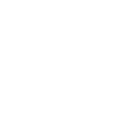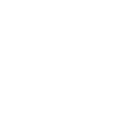Patricia Forget copréside un groupe de travail national sur le Système archivistique canadien
L’archiviste et muséologue de l’UQO, Patricia Forget, a été choisie pour coprésider le groupe de travail sur la main d’œuvre du Comité directeur des archives canadiennes qui se penchera sur l’élaboration d’un plan d’action. Le but est de favoriser la collaboration entre les membres de la communauté des archivistes au Canada, et ce, afin de mieux faire face aux défis et aux nouvelles avenues qui sont ceux du monde numérique.
Ce groupe de travail, ainsi que deux autres, ont été créés par le comité directeur du Système archivistique canadien afin d’établir leur plan d’action pour les dix prochaines années.
« C’est un grand honneur puisque cette initiative fait directement suite au Sommet sur les archives au Canada, en novembre 2015, au cours duquel un nouveau plan directeur a été adopté afin de recadrer (changer et restructurer) le Système archivistique canadien et du coup sa vision pour les années à venir », a expliqué madame Forget.
La stratégie qui sera élaborée se penchera aussi sur les occasions offertes par le monde numérique et de voir comment mieux répondre aux défis qu’il présente pour la conservation numérique.
« Au lieu de simplifier les choses, l’arrivée des nouveaux médias crée, au contraire, une confusion entre les données essentielles d’une institution et les données superflues, ajoute madame Forget. Cette confusion est d’autant plus réelle que la création de médias de masse et de données n’a jamais été aussi facile, ce qui crée un problème de quantité qui augmente d’autant plus cet imbroglio. Il est donc encore plus important aujourd’hui de bien différencier ce que l’on doit garder de ce que l’on ne doit pas conserver, et ce, dès leur création, avant même que le chaos ne s’installe. »

Voilà pourquoi l’archiviste du XXIe siècle doit absolument se positionner dès la création de cette information, précise-t-elle. Il doit établir en collaboration avec les créateurs de cette information les conditions nécessaires à la conservation.
![]()
Patricia Forget explique que trois éléments doivent être clairement définis, documentés et normalisés: d’abord, l’identité (formats de conservation; dates de création; contexte; contenu approuvé par le responsable de cette information; forme physique et intellectuelle; les noms des créateurs et personnes responsables du contenu; signature; documents afférents; etc.), ensuite, l’intégrité (capacité à s’assurer que le contenu n’a pas été modifié depuis sa création et son officialisation) et enfin, l’authenticité (établir au niveau de l’identité et de l’intégrité des critères d’une précision telle qu’il sera facile, par la suite, de valider le tout à l’aide de modèle électronique.)
La complexité des nouvelles technologies implique que l’ensemble du corps professionnel d’une institution s’y penche : informaticiens, archivistes, avocats, agents de communication, etc. Par conséquent, l’approche multidisciplinaire (muséologique) s’avère souvent la plus adaptée, puisqu’elle implique de considérer l’entièreté de la problématique afin de répondre à la mouvance de ces nouveaux environnements et de l’obsolescence programmée.
Selon Patricia Forget, il s’agit d’un défi majeur pour les institutions car celles-ci fonctionnent souvent en vase clos. Une volonté nouvelle de la classe dirigeante doit émerger afin de les conscientiser sur leur rôle, mais également sur les solutions envisagées. Les dirigeants doivent non seulement permettre, mais favoriser la création d’équipes interdisciplinaires.
C’est un revirement de situation, un changement complet de perception du travail de l’archiviste, ajoute madame Forget, qui cite le rapport du Comité d’experts sur les institutions de la mémoire collective et la révolution numérique du Conseil des académies canadiennes.
Patricia Forget a d’ailleurs parlé des enjeux de la conservation numérique du patrimoine lors d’une entrevue accordée à l’émission L’heure de pointe, le 29 septembre 2016, diffusée à Ici Radio-Canada Toronto. Vous pouvez écouter l’entrevue en cliquant ici.
Madame Forget est également active dans la communauté des archivistes au Québec. Elle a participé, plus tôt cette année, à une conférence intitulée Documents et technologies : les archivistes à l’heure du 2.0, qui se déroulait à Gatineau. L’évènement, une première du genre en Outaouais, était organisé par l’Association des archivistes du Québec, région Ouest.
Les archivistes sont également présents avec les médias sociaux. Ils peuvent, par exemple, faire appel au public pour des documents. Il y a aussi les partages des banques de données sur la Toile.
Le Système archivistique canadien est constitué de deux associations professionnelles : soit l’Association of Canadian Archivists (ACA) et l’Association des archivistes du Québec (AAQ); du Conseil canadien des archives, qui agit comme organisme de coordination du CCA et qui représente les conseils provinciaux et territoriaux des archives (conseils PT) et les institutions; du Conseil des archivistes provinciaux et territoriaux (CAPT), qui représente les institutions gouvernementales provinciales et territoriales responsables des archives; et de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).
CLIQUEZ ICI POUR RETOURNER AU MAGAZINE SAVOIR