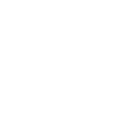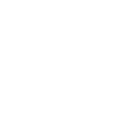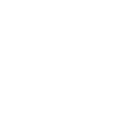Le professeur Martin Laberge présente le drame des réfugiés syriens dans une perspective historique
Le professeur Martin Laberge a captivé son auditoire, le jeudi 10 mars dernier, en présentant le rapport entre les relations internationales contemporaines, les réfugiés et les sociétés occidentales avec, en toile de fond, les réfugiés syriens qui fuient présentement la guerre civile dans leur pays pour venir s’établir au Canada.
![]()
« Les réfugiés incarnent la face tragique des grandes transformations internationales de notre temps », a expliqué l’historien devant une centaine de personnes réunies pour sa conférence dans la Grande salle du pavillon Alexandre-Taché.
![]()
Offerte gratuitement au grand public et à la communauté universitaire, la conférence a été présentée par Action Réfugiés UQO. Ce comité, formé de professeurs, d’étudiants et d’employés de l’UQO, présente depuis février une série d’initiatives afin de faciliter l’accueil et l’intégration des réfugiés. Dans le cadre de ces initiatives, la direction de l’UQO a notamment annoncé qu’elle offrira des bourses à des étudiant(es) réfugiés.
Lors de sa conférence, le professeur Laberge a souligné que, depuis 1914, la figure du réfugié est devenue une des images symboliques associées aux transformations des relations internationales contemporaines. Que ce soit les civils belges en 1914, les républicains espagnols en 1939, les réfugiés de la mer vietnamiens en 1975 ou les populations syriennes aujourd’hui, ces groupes incarnent la face tragique des dislocations du système international aux XXe et XXIe siècles.
Monsieur Laberge a également présenté la grande ligne de sa conférence intitulée Du sac de Louvain au siège de Madaya, 1914-2016, en entrevue à l’émission Les voies du retour, à Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Il a alors expliqué qu’à la suite de l’invasion allemande de la Belgique en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le sac de Louvain a forcé le déplacement de milliers de personnes. « Des Belges ont commencé à fuir le pays et à trouver refuge ailleurs, entre autres en France et en Grande-Bretagne », a souligné Martin Laberge. « Et à partir de cet évènement, je veux faire comprendre aux gens que les réfugiés, et la figure du réfugié […] nous accompagnent depuis 1914 ».


Tout comme les réfugiés syriens qui risquent leur vie sur la mer Méditerranée aujourd’hui, les réfugiés belges ont souvent fait la traversée de la Manche, vers l’Angleterre, dans de petites embarcations, au péril de leur vie.
À la suite de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a joué un rôle crucial dans la définition du statut des réfugiés. Le réfugié se définit alors comme une personne qui est privée, dans son pays d’origine, de ses droits politiques et à qui on doit venir en aide. Après la Seconde Guerre mondiale, le travail de l’ONU a mené, en 1951, à la convention relative au statut des réfugiés.
« Le rapport des sociétés d’accueil avec les réfugiés n’est pas un cycle. C’est plutôt un va-et-vient irrégulier où ils sont parfois accueillis à bras ouverts et où parfois on refuse de les accueillir », a également expliqué le professeur Laberge.
Il a ainsi proposé l’exemple les réfugiés de la guerre civile en Espagne, en 1939, qui ont fui vers la France. Ces réfugiés ont été perçus de façon suspecte par la société française.
Quant aux réfugiés syriens d’aujourd’hui, Martin Laberge estime qu’il faut à la fois une action individuelle, ou de groupes de personnes, pour leur venir en aide, mais aussi une intervention concertée des États qui doivent agir en commun, comme le souhaitait la Société des Nations en 1919.
Le comité Action Réfugiés UQO, en collaboration avec la Ville de Gatineau, présentera une autre activité grand public, le samedi 2 avril 2016. Cliquez sur ce lien pour plus de détails.
CLIQUEZ ICI POUR RETOURNER AU MAGAZINE SAVOIR